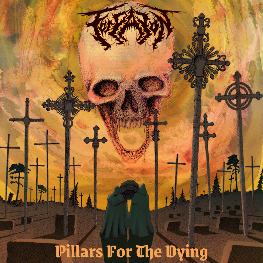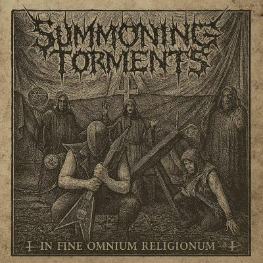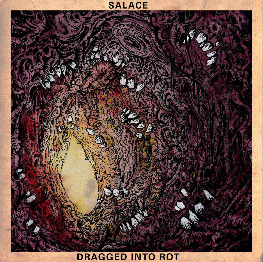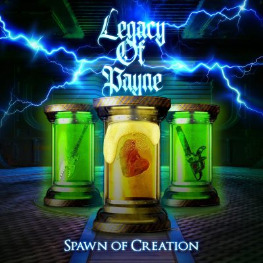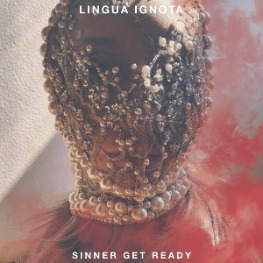Disturbing Music : Ascenseur pour l'échafaud
Divers

Si les images impriment nos rétines de souvenirs parfois douloureux, les sons et les mots se fraient aussi un chemin dans notre conscient/inconscient, au point de nous rendre capable des années après avoir entendu une chanson de nous souvenir précisément des sentiments éprouvés à ce moment-là. La plupart du temps, ces sentiments en appellent au ressenti le plus primaire et essentiel, l’exemple type étant « la chanson de couple » qui se joue à intervalles réguliers dans les jeux de l’amour et de la mémoire. Mais il arrive parfois que ces mélodies nous impressionnent au point de nous faire trembler des décennies plus tard, alors que l’enfance est morte de sa belle mort depuis longtemps.
A chacun sa sensibilité. Pour ma part, je reste traumatisé par des anecdotes télévisuelles à base de réclame, et n’ai jamais pu oublier la terreur dans laquelle me plongeait la musique de la réclame Ariel dans les années 70. Car nous avons tous notre champ de perception, et parfois, des incarnations totalement anodines nous perturbent au point de créer un point zéro du courage, nous immobilisant en plein discours. Alors, quelles sont ces chansons qui nous ont à ce point effrayés ? Le choix est vaste, et si pour beaucoup, certains styles musicaux semblent émaner de l’imagination la plus diabolique, pour d’autres, des bandes-originales de film, des fréquences particulières, ou des morceaux pointus d’albums classiques incarnent la quintessence de l’horreur la plus viscérale.
Nous aurions beau jeu de considérer notre musique de prédilection comme réservoir inépuisable de frayeur pour le plus grand dénominateur commun. Si le Heavy Metal et son iconographie occupe une bonne place au tableau d’horreur, si ses sous-genres ont parfois accouché d’œuvres traumatiques, c’est ailleurs qu’il m’a fallu chercher de quoi alimenter ce dossier sur les morceaux/albums les plus traumatiques, effrayants, oppressants, malsains, et autre réaction épidermique.
Je ne vous parlerai donc pas de MAYHEM, de NINE INCH NAILS, de BURZUM, d’ABRUPTUM, de KORN ou de SLIPKNOT. Car aussi glauques certaines chansons puissent être à l’intérieur de notre cercle d’initiés, c’est bien à l’extérieur qu’il faut chercher de quoi alimenter les chapitres de ce dossier. Bien évidemment, ce choix et cette playlist sont subjectifs. Il en appelle à la sensibilité de chacun d’avaliser mes options, mais je m’en tiendrai à ces choix qui me semblent pertinents, mais auxquels on pourrait ajouter d’autres exemples tout aussi probants.
Le choix a été difficile, et certaines évidences évitées par principe. Cette thématique ayant déjà été traitée sur le net, notamment par l’excellent Youtubeur Feldup, j’ai tenté d’éviter les recoupements trop nombreux, même si quelques morceaux sont communs à ces autres listes.
J’ai donc pris en compte plusieurs paramètres, dont l’ambiance du morceau, son thème, sa place dans l’histoire de la musique, la controverse qu’il a pu soulever, l’interprétation ou au contraire l’instrumentation, et je pense avoir réuni plus de trente pièces d’importance que vous connaissez peut-être déjà, ou qui vous permettront de découvrir des artistes dont vous n’aviez jamais entendu parler. Pas de Metal donc, mais la puissance n’en est pas pour autant négligée. Certains de ces titres dégagent en effet une chaleur équivalente à une turbine Black Metal lancée à plein régime, tandis que d’autres utilisent les silences et le minimalisme pour exprimer un malaise tangible.
N’hésitez pas dans les commentaires à citer des exemples plus personnels, histoire d’enrichir ce recensement loin d’être exhaustif. Il est aussi possible que la plupart des morceaux ne vous fassent ni chaud ni froid, tandis que d’autres lecteurs en tressailliront de plaisir tremblant. Bienvenu dans l’immeuble de la peur, et appelez l’ascenseur. Et plus il descendra, plus la lumière manquera et plus les poils se dresseront sur vos bras.
Niveau 0 - Musique d’ascenseur
1 - SIOUXSIE AND THE BANSHEES - « Mother / Oh Mein Papa » (Join Hands, 1979)
Susan Janet Ballion aka Siouxsie SIOUX faisait partie, comme tant d’autres, du fameux Bromley Contingent, ce panel de fans des SEX PISTOLS qu’on retrouvera en partie durant la fameuse émission de Bill Grundy, The Grundy Show. Les images d’époque montrent une jeune fille certes peinturlurée comme une voiture volée à la frontière de la Roumanie, mais qui joue les ingénues face aux tentatives de séduction du vieil animateur libidineux.
Mais Siouxsie, avant d’être fan, était elle aussi une musicienne. Ses premiers pas furent accomplis sur la scène du 100 Club, en compagnie d’un certain Sid Vicious à la batterie, sous le nom de SUZIE AND THE BANSHEES. Si ce concert fut en termes artistiques assez pauvre, il n’en reste pas moins historique pour les fans de la belle en noir. Quelques années plus tard, accompagnée d’un line-up plus rodée, la chanteuse fondera SIOUXSIE AND THE BANSHEES.

SIOUXSIE AND THE BANSHEES incarne pour beaucoup la quintessence de la Cold Wave, et la scène gothique ne tarda pas à faire de Siouxsie son égérie. Toujours habillée de noir, les yeux fardés, la chanteuse avait des allures de prêtresse sur scène, oracle d’infortune d’un mouvement Punk mort de n’avoir pas voulu vivre. Le premier album du groupe, The Scream, est aujourd’hui un classique des soirées noces et banquets des amateurs d’un Halloween permanent, mais c’est sur Join Hands, le second LP, qu’on trouve l’un des titres les plus traumatiques de la chanteuse.
« Mother / Oh Mein Papa » est l’acmé de cet album. Planté en pénultième titre, il est construit sur une mélodie de boîte à musique, sur laquelle Siouxsie brode des paroles enfantines qu’elle déclame d’une voix totalement atonale, spécialité des instincts Post-Rock de la fin des années 70.
Downstairs I don't know (Downstairs I don't know)
If it's the springs in her bed (Why I feel safe in my bed)
Or her joints I hear (When I know I'm alone)
Creaking overhead (She must be watching overhead)
Mother (Mother)
Chanson d’amour/haine filial/parental, « Mother / Oh Mein Papa » est un classique du glauque estampillé gothique de cette année 1979. S’il est certain que sa présence dans ces lignes est due à cette boite à musique infernale qui tourne pendant trois minutes sans changer de mélodie, l’association de cette linéarité, du caractère enfantin de l’objet, qui trône alors sur nombre de tables de nuit de petites filles, et des mots de Siouxsie, cruels et inquiétants, en font une sorte d’hymne à la peur infantile, et à la servitude d’une enfant entièrement dévouée à l’amour de sa mère. Un titre que j’ai découvert sur le tard, sur une compilation que m’avait concoctée une amie, et qui, comme vous vous en doutez, comprenait un certain nombre de morceaux présents ici.
2 - JANE AND BARTON - « It’s a Fine Day » (Jane And Barton, 1983)

It's a fine day
People open windows
They leave their houses
Just for a short while
Cette chanson sortie de nulle part a été éditée par le label anglais Cherry Red en 1983 en single. Composée par Edward Barton, poète et musicien originaire de Manchester, elle reste un mystère total. Interprétée à cappella par Jane Lancaster, l’ex-petite-amie de Barton, elle propose une mélodie simple sur des paroles ne l’étant pas moins, évoquant une après-midi d’été comme les autres en Angleterre. Alors, me direz-vous, quid de sa présence ici ? Je ne cacherai pas que son ambiance étrange et son clip en noir et blanc m’ont toujours mis mal à l’aise, même si les mots de Jane se veulent rassurants, et semblent sortir de la bouche d’une mère de famille désireuse d’endormir son enfant à l’aide d’une jolie berceuse.
Intégrée par la suite à un album bizarre, éponyme, elle reste très ancrée dans le répertoire Indie anglais, mais doit aussi une partie de sa notoriété sombre à son utilisation dans une publicité Kleenex japonaise, découverte sur Youtube et à l’origine de nombreuses légendes urbaines. Cette publicité, somme toute assez normale au départ, prend une tournure inquiétante à mesure que l’image se distord et que la bande-son sature au-delà du raisonnable. Certains, amateurs de mythes ont cru y voir une publicité maudite, déclenchant une malédiction chez tous ceux l’ayant regardée. Une sorte de Ringu moderne, qui évidemment n’avait aucun fondement.
La mélodie accompagne une iconographie assez étrange, et sert admirablement bien le faux propos de cette fameuse « pub maudite » que les internautes ont débunké à loisir. Il faut dire que la présence d’un bébé peint en orange avec une tête de brocolis n’a rien arrangé à l’affaire, la combinaison de ces divers éléments faisant de « It’s a Fine Day » une sorte de fausse comptine maléfique. Ajoutez à ça la rumeur soulignant que la vidéo changeait d’apparence à minuit pour devenir franchement flippante, et vous avez tous les ingrédients d’une histoire glauque.

En définitive, il ne s’agit que d’une superbe ballade sans instrumentation qui a traversé les années pour devenir un classique. Mais aujourd’hui encore, son côté évanescent et presque irréel en fait l’une des chansons les plus étranges de son époque, et susceptible de créer le malaise chez les auditeurs les plus imaginatifs et sensibles.
3 - TINY TIM - « Tip-Toe Thru the Tulips » (God Bless Tiny Tim, 1968)
Herbert Buckingham Khaury aka TINY TIM est un personnage haut en couleurs de la scène musicale américaine. Né en 1932 à Manhattan, il a rapidement été fasciné par l’expression musicale, et spécialement celle de l’époque 1890/1930. Garçon timide, il écoute les vieilles rengaines à la radio, et commence à les chanter lui-même. Il se rend très vite compte qu’il est capable de monter très haut dans les aigus, et de maîtriser ce fameux falsetto, si difficile à contrôler pour la plupart des hommes.

Il participe alors à nombre de télé-crochets, qu’il gagne parfois haut la main grâce à son timbre de voix unique, et à son personnage tenant autant de Buster Keaton que d’une version Lewis Carroll de Brian Wilson. En 1968 , après avoir traîné sa carcasse un peu partout, s’affichant parfois avec un sac en plastique de supermarché, il signe un contrat lucratif avec le label Reprise Records, et lâche à la face d’un monde médusé un God Bless Tiny Tim totalement anachronique.
En pleine vague psychédélique, TINY TIM a tout pour plaire. Son look, improbable en costume du dimanche pour jeunes filles en fleurs, sa musique, décalée et hors du temps, et sa voix, unique et magnifique. Le single « Tip-Toe Thru the Tulips », œuvre de Nick Lucas devient très rapidement le hit le plus imprévisible de l’époque, et l’artiste enchaîne les disques et les galas.
Bien que tout à fait charmante, « Tip-Toe Thru the Tulips » reste une chanson étrange, en grande partie à cause de la voix très haut-perchée de Tim. Si le propos est plus excentrique que réellement effrayant, c’est le statut de la chanson qui laisse un goût amer dans les oreilles. D’écoute facile et entraînante, avec ce ukulélé festif et enfantin, on pense à une version hyper concentrée du Magicien d’Oz, après une sévère charge de LSD.
TINY TIM la chantera toute sa vie. Régulièrement remis au goût du jour, il revient sous les feux de la rampe, jusqu’à ce dernier concert en 1996. Très mal en point, mais désireux de ne pas décevoir son public, il jouera finalement au Women's Club de Minneapolis, et terminera évidemment son tour de chant par l’immortel « Tip-Toe Thru the Tulips », qui sera son dernier tour de piste. Pris d’un malaise pendant la chanson, il est transporté au Hennepin County Medical Center, où les médecins tenteront de le ranimer pendant une heure et quinze minutes, en vain.

Célèbre par cette chanson, TINY TIM en est mort. Ce qui la rend encore plus tragique, et particulière à l’écoute une fois l’histoire connue. A noter qu’on trouve un superbe portrait de lui sur la pochette du grandiose Feel the Darkness des POISON IDEA, et qu’un documentaire (Tiny Tim: King for a Day) lui a été consacré par Johan von Sydow. A voir absolument, ne serait-ce que pour comprendre le fait que TINY TIM a toujours été considéré comme le parrain de la mouvance Outsider Music, si bien représentée par un autre artiste de cette liste. Mais ceci est une autre histoire. Ou presque
4 - JAD FAIR & DANIEL JOHNSTON - « If I’d Only Known » (Jad Fair And Daniel Johnston, 1989)
L’entrée précédente abordait le cas de l’Outsider Music, genre typiquement américain, qui mérite une définition claire pour une meilleure compréhension :
L'Outsider music représente les auteurs compositeurs qui ne font pas partie de l'industrie musicale, qui composent des chansons en ignorant les standards musicaux, ou qui les contournent sciemment ou non, soit parce qu'ils n'ont aucune formation musicale, soit parce qu'ils refusent de se soumettre à ses règles. Ce genre musical, souvent indescriptible et joué à l'instinct connaît une faible distribution ainsi qu'une promotion quasi nulle ; ces artistes font leur renommée par bouche à oreille, la plupart du temps parce que leurs œuvres sont recherchées par des collectionneurs.

Or, on ne peut trouver meilleure définition pour décrire la musique de Daniel JOHNSTON. Daniel Dale Johnston, né le 22 janvier 1961 à Sacramento est l’un de ces anti-héros dont l’Amérique est si friande. Enfant tout à fait normal, puis adulte difficile, Daniel se met très tôt à jouer de la musique, principalement au piano, instrument qu’il maîtrise le mieux, et commence à enregistrer sur cassette des albums bricolés à la maison. Son premier album autoproduit, The What Of Whom, concentre l’essentiel de son œuvre : tempo chancelant, voix mal assurée et presque cartoon, arrangements inexistants, et paroles tantôt enfantines, tantôt déprimantes.
Il faudra attendre Hi, How Are You: The Unfinished Album pour que le bonhomme commence à se faire connaître, et fasse quelques concerts épars dans la région. Ce troisième album trouvera quelques années plus tard un énorme écho auprès de la génération Seattle, Kurt Cobain arborant le t-shirt au motif de gentil monstre de sa pochette pendant des années.
Daniel parviendra même à signer sur une major, Atlantic, en 1994 pour l’enregistrement de l’album Fun. Vite renvoyé au regard des pauvres cinq-mille copies écoulées, il retournera dans l’ombre et continuera de produire des disques toujours aussi sincères, et miroirs de sa propre vie.
Il faut savoir plusieurs choses à propos de Daniel. Diagnostiqué bipolaire, il fera de nombreux allers et retours dans des institutions, rentrant chez ses parents pour passer sa convalescence, ou partant à New-York avec Jad Fair pour enregistrer un album avant de disparaître corps et âme au cours d’une fugue impromptue. Son caractère ombrageux lui vaudra de nombreux ennuis, mais lui coutera surtout sa santé mentale, sa pire époque étant agitée de révélations divines et de la peur de Satan, qu’il voyait partout autour de lui.
Pour illustrer son parcours et mettre en lumière sa part d’ombre, j’avais un choix considérable de chansons. Avoir opté pour « If I’d Only Known », qu’on trouve sur son album en duo avec le flingué Jad Fair (l’une des moitiés Fair du groupe ½ JAPANESE, autre exemple criant de la folie américaine lo-fi) est tout sauf un hasard et un choix par défaut, et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, pour souligner l’attention dont a bénéficié Daniel durant toute sa vie de la part d‘artistes underground confirmés, mais aussi pour son caractère étrange, bricolé à la va-vite, joué avec les pieds, et symptomatique d’une association entre deux outsiders loin de l’école mainstream.

La musique de « If I’d Only Known » est évidemment très bancale, inécoutable pour une oreille rompue au solfège, mais c’est surtout son texte poignant qui en fait un morceau aussi triste que flippant.
If I'd only known, I could have said something sooner
But I didn't, so I didn't, now it's done
The last thing I'd do was the first thing you did
What we once had is all gone
I see it all, a little too clear
Too clear for my own good
"Let sleeping dogs lie" is a good rule, I'm told
I only wish that it would
If I'd only known, I could have said something sooner
I really did think it would last
Now it's too late, it's over now
My future is all in my past
Le dernier vers est à ce titre très prophétique, Daniel se réfugiant constamment dans son passé pour oublier son présent, alors même que son passé était encombré de mauvais souvenirs. Un amour d’adolescence déçu, des crises difficiles à gérer, l’inquiétude de ses proches, et cette affection témoignée par un public fidèle, réellement passionné par sa musique, mais qui l’obligeait à se découvrir, chose qu’il finit par détester, malgré ses passages triomphants lors de festivals. La vie de Daniel était évidemment régie par des détails futiles pour le commun des mortels (Daniel tenait à ce que chacune de ses cassettes soit enregistrée en entier et live, et refusait de faire de simples copies, ce qui en dit long), et finit assez tristement et prématurément le 11 septembre 2019, alors que Daniel n’avait même pas atteint la soixantaine.
On ne peut pas connaître son histoire et écouter ce morceau sans avoir quelques frissons. Car l’histoire de Daniel est celle de milliers d’autres inconnus, aussi malades et paumés que lui, et qui trouvent refuge dans le dessin, la solitude, la colère, le rejet ou la drogue dans le pire des cas. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce musicien devenu culte depuis longtemps, je ne saurai que trop vous conseiller de regarder le magnifique et poignant documentaire The Devil and Daniel Johnston, sorti en 2005, qui vous offrira une vue d’ensemble de ce personnage aussi attachant qu’étrange. Son but était de devenir une star à tout prix, et quelque part, il a réussi. Mais justement, à quel…prix.
5 - TORI AMOS - « Raining Blood » (Strange Little Girls, 2001)

La reprise est un art fort complexe, jugé mineur par certains qui ne l’envisagent que sous un seul angle, mais qui peut devenir un exercice de modelage sublime pour peu que l’interprète ose transfigurer l’œuvre originale pour se l’approprier. Les albums de reprises étant nombreux, et souvent transitoires entre deux sorties officielles, on se montrera très précautionneux dans le choix des disques méritant l’intérêt. Mais s’il est un cover album qui mérite tous les louanges que vous pourrez lui chanter, c’est bien Strange Little Girls de Tori AMOS.
Lorsque Strange Little Girls sort, Tori AMOS est déjà sur orbite depuis longtemps. Enfant des années 80, elle est considérée comme la Kate BUSH des nineties, grâce à des albums comme Little Earthquake ou Under The Pink. Ses singles « Crucify » et « Cornflake Girl » sont des classiques de la première moitié des années 90, matraqués par les FM et MTV, et en 2001, deux ans après la sortie de l’impeccable To Venus and Back, personne n’attend la chanteuse de Caroline du Nord au rayon des appropriations incongrues ou non.
Alors que son premier album, déjanté et dansant reste un fantasme absolu pour de nombreux fans (il sera enfin réédité officiellement et proprement par Atlantic en 2017), Myra Ellen Amos de son état-civil continue d’expérimenter pour surprendre, et nous offre cet écrin rempli de douze gemmes, toutes aussi brillantes les unes que les autres.
Le tracklisting offre quelques certitudes, des admirations évidentes, des choix osés, entre 10CC, les BOOMTOWN RATS, les BEATLES, DEPECHE MODE, mais taquine aussi EMINEM, les STRANGLERS, LLOYD COLE, et beaucoup plus étrangement…SLAYER.
Ses fans ont dû se frotter les yeux en découvrant cette reprise sur la pochette de l’album, l’univers de Tori étant aux antipodes de celui des rois du Thrash et de leur classique de 1986, Reign in Blood. Et on peut les comprendre avant d’en avoir écouté la moindre note, une version piano/voix étant tellement improbable que les spéculations paraissent vaines. Et pourtant, non seulement Tori s’en sort, mais elle se permet de présenter une version encore plus puissante et flippante que l’originale.
Difficile à croire ? Je le concède, la version de SLAYER étant réputée comme étant un classique de la violence made in California depuis quinze ans. Et d’abord, quelle mouche a pu piquer la chanteuse pour qu’elle décide de s’attaquer à un truc pareil ? L’explication de cet album et de ces choix est simple :
[…]Pour cet album, elle n'a pas choisi de choisir parmi ses chansons préférées pour en faire un album personnel. Au contraire, elle a décidé que le choix idéal serait de choisir une série de chansons exclusivement masculines et de les réinterpréter dans une perspective féminine. « La manière dont les hommes disent les choses m'a toujours fascinée. la façon dont les femmes les entendent me fascine d'autant plus[…]
Si la majorité des reprises déforme l’original au point de le distendre dangereusement, « Raining Blood » va au-delà du simple lifting. La chanteuse a tout simplement gommé les riffs pour proposer un accompagnement de piano sépulcral, sur lequel vient se greffer un chant atonal et éthéré, comme une prière païenne au bout de la nuit. Exit donc les accélérations fumasses, au-revoir les cris de Tom Araya, la relecture féminine a traduit l’original comme une comptine infernale à destination d’enfants pas très sages. Et le résultat est tout simplement magnifique. Le final du morceau, acmé de brutalité devient un cauchemar sonore à la DEAD CAN DANCE, et si le texte est gardé tel quel, l’ambiance est complètement travestie, tout comme les treize personnages de femmes jouées par Tori AMOS pour accompagner chaque reprise.
Et ça file la chair de poule. A la manière d’une Chelsea Wolfe, des années avant son explosion, ou d’une Diamanda Galas apaisée, Tori AMOS provoque le Metal pour lui donner une leçon de majesté et de ténèbres, et - Ô surprise - SLAYER se montrera fort honoré par cet hommage, et enverra même à l’artiste un t-shirt God Hates Us All.
Je vous invite à écouter religieusement cet album qui, à mon très humble avis, reste le meilleur disque de reprises jamais enregistré par un/une artiste.
6 - MATT ELLIOTT - « The Kursk » (Drinking Songs, 2004)
It's cold I'm afraid
It's been like this for a day
The water is rising and slowly we're dying
We won't see a light again
We won't see our wives again
C’est tout ce que cette superbe chanson vous dira, rien de plus. Mais c’est déjà beaucoup. Comme une chanson de marins perdus dans les limbes des océans, « The Kursk » est une chanson de tristesse, de résignation, et d’acceptation du non-lendemain. Et à ce titre, portée par une mélodie à la guitare acoustique, elle mérite amplement sa place dans ce dossier.

« The Kursk » est quelque part aussi effrayant qu’une vie qui se termine abruptement, sans un dernier adieu. Elle symbolise la solitude de tous ces marins perdus en mer, mais peut aussi se transposer à notre époque, évoquant les catastrophes à venir d’une humanité en perdition totale, les uns isolés à gauche et les autres coincés à droite.
Son ambiance éthérée, ses voix fantomatiques, contribuent à renforcer le malaise, comme celui que palpent les oubliés, dans les couloirs de l’antichambre de la mort, quelques instants avant leur dernier souffle.
Originaire de Bristol, Matt ELLIOTT a d’abord été l’homme derrière THE THIRD EYE FOUNDATION, fondé en 1994 comme projet solo. Puis il a repris son propre nom pour publier des albums d’une beauté troublante, dont on retiendra évidemment sa tétralogie Songs, sortie en coffret, et indispensable. La musique de Matt est comme ces anciens albums photo qui reviennent à la vie l’espace d’une soirée. Ces instants volés et fanés qui nous rappellent à quel point le temps passe vite, et comme les disparus nous manquent toujours. Sorte de disciple Ambient/Drum n’Bass de Nick DRAKE, ELLIOTT explore l’âme humaine comme un capitaine sillonne les flots, et en revient les partitions chargées de notes fanées et d’ambiances étranges, presque occultes.
J’aurais pu pour illustrer sa présence ici choisir n’importe quel morceau de son premier album, le magnifique The Mess We Made. Mais c’est bien « The Kursk » qui mérite d’être citée, pour ces vers tragiques et ces harmonies d’un autre siècle. Sorte de berceuse pour hommes de la mer burinés par les embruns, elle illustre parfaitement l’optique musicale d’un musicien totalement à part sur la scène anglaise, prisonnier de ses démons, et créateur de son propre monde.

Les chœurs qui reviennent comme des vagues à l’assaut du navire, ce silence progressif qui symbolise la disparition inéluctable, et ce sel qui se colle à la peau par musique interposée rendent « The Kursk » extrêmement troublant au point de dessiner une frontière entre la vie et la mort, en quelques minutes seulement. La musique de Drake évoquait le ressac, la nuit, cette mousse se déposant sur les plages. Celle de Matt ELLIOTT, cet alcool qu’on boit pour oublier qu’on est seul, que l’on va mourir, et qu’il n’y a rien à faire. Jamais chanson n’aura si brillamment incarné la houle et le roulis, les yeux embués, et les bonnets vissés sur des cranes déjà trop fatigués.
Une façon de nous rappeler que tout peut basculer d’un jour à l’autre, et qu’il n’y a rien à faire. A part pleurer nos épouses restées à terre, et qui savent déjà qu’elles passeront le reste de leur existence seules. Dans le deuil le plus absolu.
7 - RANDY NEWMAN - « In Germany Before the War » (Little Criminals, 1977)
In Germany before the war
There was a man who owned a store
In nineteen hundred thirty four
In Dusselford…
Cette chanson de Randy Newman, auteur-compositeur-interprète américain né en 1943 à Los Angeles est une petite merveille. Le genre de joyau qu’un album cache parfois, et qu’on découvre pour la première fois totalement hébété devant tant de magnificence. Incluse sur l’album Little Criminals, son hit de 1977, « In Germany Before the War » a tout d’abord l’allure d’une chanson sombre sur l’Allemagne d’avant-guerre, mais en poussant plus loin, on devine quelque chose de beaucoup plus sombre qu’un vieux souvenir.
Cette mélodie nostalgique et passée cache en fait une histoire bien plus malsaine, sur un thème qui deviendra vite récurrent en ces lignes. Alors que le personnage semble regretter la mer en contemplant une rivière, évoquant ces fameuses chansons de marins frustrés d’être à terre trop longtemps, il s’avère qu’il n’est pas seul dans cette histoire, comme le souligne le second couplet :
A little girl has lost her way
With hair of gold and eyes of gray
Reflected in his glasses
Jusque ici, rien de vraiment gênant, même si on devine que le propos du morceau n’est pas simplement d’évoquer la rêverie solitaire d’un tenancier d’échoppe allemande. Et alors que les violons soulignent de leur tragédie les notes de piano frappées avec force, le vrai dessein de l’homme commence à apparaître :
As he watches her
A little girl has lost her way
La rencontre apparaît soudainement plus inquiétante, et on commence à se dire que les intentions du personnage ne sont certainement pas des plus saines. Et effectivement :
We lie beneath the autumn sky
My little golden girl and I
And she lies very still
Inutile de vous faire un dessin quant au destin de cette pauvre petite fille aux cheveux d’or, qui est « si tranquille sous le ciel d’automne ». Difficile de créer un plus gros décalage entre une musique et un texte, et ce genre de mise en scène est peu coutumier de Randy Newman, volontiers plus à l’aise dans son rôle d’observateur cynique de l’Amérique moderne.

Il n’en reste pas moins que « In Germany Before the War » instaure un véritable malaise, et reste à ce jour une sacrée incongruité dans le catalogue du californien. Rappelons pour mémoire qu’il fut secondé sur cet album par des pointures de l’envergure de Ry Cooder, Jim Keltner, Glenn Frey, Don Henley et Joe Walsh, ce qui ne l’a nullement empêché de graver ce morceau pour l’éternité, laissant un goût très amer dans la mémoire de ses fans. Une thématique sordide, mais omniprésente dans les dossiers comme celui-ci.
Niveau -1 : Le Parking Abandonné
8 - LISA GERMANO - « A Psychopath » (Geek The Girl, 1994)
« A Psychopath » est résolument une chanson à part dans la carrière de Lisa Germano. L’auteure/compositrice/interprète de l’Indiana, déjà responsable de deux albums très remarqués, signe avec Geek the Girl l’un des disques les plus fondamentaux des nineties. Hébergée alors par l’écurie 4AD, connue pour son cheptel obsédé par le spleen, la décadence, le deuil et autres arias en envolées lyriques, Lisa est une référence de la scène Alternative/Folk US, et ce troisième album sera celui de l’explosion. A juste titre.

Le tracklisting de cet album est typique de ceux de la fameuse « troisième étape », qu’on considère souvent comme la plus difficile et importante d’une carrière d’artiste. On y trouve tout ce qui a fait la réputation de cette chanteuse exceptionnelle, à la voix enfantine et aux textes ancrés dans leur époque. Mais au milieu de toute cette prévisibilité, se cache un titre étrange, effrayant et terriblement sombre.
« A Psychopath » dévoile son propos dès son titre. Sur le même thème que la scie radiophonique de POLICE, « Every Breath you Take », Lisa GERMANO nous parle d’une expérience traumatisante qu’elle a vécue, et décidé de mettre en musique. Une fois encore, c’est le décalage énorme entre le fond et la forme qui choque le plus les oreilles. Lisa raconte en effet, à sa façon, la terreur née suite à l’agression constante d’un harceleur, qui la suivait jour après jour. Mais au lieu de pondre un titre larmoyant ou au contraire, au vitriol à la façon d’une Alanis Morissette ou d’une LINGUA IGNOTA, Lisa opte pour un contrepied, et une sorte de berceuse à la « Asleep » des SMITHS.
Chantant d’une voix onirique, Lisa choisit ses mots, et ne signe qu’un grand couplet, sans refrain, dont les vers font froid dans le dos. La scène décrit une femme alitée, une batte de baseball près de sa couche, qui entend du bruit dans sa maison.
A baseball bat, a baseball bat beside my bed
I'll wait around and wait around, and wait
I hear a noise, I hear a noise, well I hear something
A mesure que la chanson avance, le propos s’assombrit, et laisse deviner une scène d’agression nocturne vécue de l’intérieur
I am alone, you win again, I'm paralyzed
I drift away, I'll drift away, am I asleep yet
I hear a scream, I see me scream, is it from memory
Am I awake, am I alone, when it is sunrise
Le reste n’est que claustrophobie, attaque de panique, terreur et témoignage poignant. Mais l’intérêt de cette chanson, et tout le bruit qu’elle a fait lors de sa sortie (alors même qu’elle était cachée en plein milieu de l’album), ne réside pas seulement dans cette opposition mélodie pure/paroles cauchemardesques. Car en effet, Lisa a utilisé un document authentique en mode field recording, qui une fois intégré au morceau lui donne une dimension encore plus terrifiante.
Après avoir vu un documentaire sur la violence (domestique ou non), Lisa a donc composé le morceau, en y insérant un sample d’un appel au 911 d’une victime qu’elle s’est procurée par le biais d’un centre d’accueil pour femmes violées (avec l’accord des personnes concernées évidemment). Cet insert, revenant à la surface tout au long du morceau renforce le malaise instauré par le script initial, et transforme cette chanson cristalline en sommet d’horreur. Les cris en arrière-plan, les mots qu’on devine plus qu’on ne les entend, la véracité de ce témoignage audio, tout a contribué à faire de « A Psychopath » l’un des morceaux les plus traumatisants des années 90, pourtant bien chargées en tristesse et autres désenchantements.
Mais le mieux est encore d’écouter cette chanson, si possible dans le cadre général de l’album, pour subir le même choc que ceux l’ayant découverte par hasard en 1994. Effet garanti.
9 - NINA SIMONE - « Strange Fruit » (Pastel Blues, 1965)
L’histoire de l’Amérique s’est écrite dans le sang. Du massacre systématique des Indiens jusqu’à l’assassinat de Martin Luther King, en passant par le financement de dictatures, le Vietnam, la Corée, Lynchburg et la stérilisation forcée des simples d’esprits, l’accueil chaleureux accordé aux anciens médecins nazis invités à poursuivre leurs expériences dans des conditions confortables, le grand livre des Etats-Unis est entaché de massacres, de serial killers, de guerres inutiles et autres mass shooting dans les écoles. Mais s’il est une période qui a soulevé le plus de remous et d’injustice, c’est bien l’esclavage et sa petite sœur la ségrégation.

Des milliers d’africains réduits à la soumission, travaillant dans les champs de coton gratuitement, ou pour une assiette de soupe claire, fouettés, maltraités, violés, dépossédés de tous leurs biens et de leur dignité. On pourrait croire cette époque révolue depuis la fin de la guerre de sécession, mais tout le monde sait que la valse morbide a continué jusque tard au vingtième siècle. Black lives matter.
No coloured. No Niggers. No Negros.
Le type même de pancartes qu’on voyait fleurir sur les commerces et autres services jusque dans les années 50. Et en parlant de ce vingtième siècle porteur d’espoir et d’égalité, il ne fut pire période que la suprématie blanche du tristement fameux Ku-Klux-Klan et son cortège de brutalité raciale et outrancièrement haineuse.
On a beaucoup écrit sur les lynchages, les assassinats commis en toute impunité, les viols en réunion, j’en passe et des crimes tout aussi infects. Le Blues a chanté la douleur et la souffrance, les Negro-Spirituals ont invoqué Dieu, et la Soul elle aussi s’est souvenue des plus tristes épisodes de cette saga inhumaine. Et dans ce grand océan des pleurs, on trouve une chanson, aussi sublime qu’elle n’est poétique dans sa description de la mort.
Popularisée par Billie Hollyday, « Strange Fruit » est sans conteste l’une des plus belles chansons du répertoire Jazz noir américain. Sa mélodie funèbre, son ambiance sépulcrale, ses mots qui se détachent comme des lambeaux de chair brûlent les cœurs les plus ardents, et évoquent des images très nettes. Mais la plus belle version de ce morceau est sans conteste l’incarnation offerte par la grande Nina SIMONE.
Southern trees bear a strange fruit
Blood on the leaves and blood at the root
Black bodies swinging in the southern breeze
Strange fruit hanging from the poplar trees
Ce fruit étrange qui pend des arbres, c’est évidemment le cadavre d’un afro-américain lynché et pendu, et dont l’odeur se mêle à celle des plantes et des fleurs. Image atroce qui vaut bien des discours, le premier couplet plante immédiatement le décor, et la voix sublime de Nina fait le reste, détachant les mots comme une prière post-mortem. On ne peut rester indifférent à ces rimes qui glacent les sangs, et qui nous rappellent à quel point une certaine Amérique blanche a trop longtemps cru à sa suprématie, dans un pays volé à des tribus devenues alcooliques et dépossédées de toutes leurs terres.
Pastoral scene of the gallant South
The bulging eyes and the twisted mouth
Scent of magnolia, sweet and fresh
Then the sudden smell of burning flesh
Chanté par SIMONE, le poème d’Abel Meeropol (1937) prend son sens le plus tragique. Inspiré de la photo de Lawrence Beitler's (1930) « Lynching of Thomas Shipp and Abram Smith in Marion, Indiana », il dénonce les lynchages, et sans le savoir, préfigure les massacres des juifs de la seconde guerre mondiale (Abel Meeropol était un juif-américain). Associé à la voix de cette interprète hors norme, il touche au merveilleux, même si son propos est évidemment profondément triste. Cette chanson sera élue « plus belle du vingtième siècle » par Rolling Stone en 1999, et fut reprise par de nombreux artistes, dont Annie Lennox, Diana Ross, Jeff Buckley, Beth Hart, UB40 ou encore SIOUXSIE AND THE BANSHEES.

Aujourd’hui encore, ce fruit étrange a un goût bien amer. Et la montée des extrêmes dans le monde entier pourrait bien engendrer d’autres chansons de ce genre, descriptifs poétiques d’un genre humain qui n’en est plus que de nom.
10 - PATTY WATERS - « Black is the Color of My True Love's Hair » (Sings, 1966)
Black is the color of my true love's hair
His face is something wondrous fair
The prettiest eyes
And the warmest hands
I love the ground whereon he stands

« Black is the Color of My True Love's Hair » est le prototype même de Folk song reprise des centaines de fois, et dont l’origine est sujette à débat ouvert. Les premières traces de cette chanson remontent à 1915, dans la région des Appalaches, mais on lui attribue généralement des origines écossaises en raison des allusions faites au fleuve Clyde dans les paroles. Ses versions divergent aussi, entre masculin et féminin, sans oublier ses vers qui de temps à autres varient quelque peu. En gros, c’est un traditionnel que tout le monde s’est approprié, et dont tout le monde a oublié l’origine. Ce que personne n’a oublié par contre, c’est la traumatique version offerte par Patty WATERS en 1966, et pour cause.
Patty WATERS elle aussi est un prototype. Celui de la chanteuse en pleine déconstruction, jouant avec les codes du Jazz, du Free-Jazz, de l’Avant-garde et ceux de son époque. Sorti en 1966, Patty Waters Sings tombe pile au bon moment, alors que les artistes du monde entier s’ouvrent à d’autres perspectives, la plupart du temps sous les effets lysergiques de drogues plus ou moins populaires. Les BEATLES ne vont pas tarder à faire sortir le Sgt Pepper de son local de répétition, PINK FLOYD aiguise ses improvisations, l'UFO Club à Londres accueille toutes les extravagances, et Miles Davis n’a pas encore accepté la fusion via Bitches Brew.
La Californie et l’Angleterre sont donc au carrefour de l’histoire, et durant ce petit laps de temps, cette petite année 1966 qui prépare le monde à être méchamment secoué l’année suivante, la jeune Patty WATERS publie deux albums, essentiels et formateurs.
Patty Waters Sings est étrangement agencé. Sur la face A, des morceaux courts de moins de deux ou trois minutes, mais déjà une voix, une impulsion, et une envie de regarder ailleurs. Loin des standards des chanteuses Pop trop polies ou des divas Soul n’Blues consacrées, Patty oppose une alternative qui fera date dans la musique, en détournant le chant féminin de son rôle premier : la séduction. L’artiste de l’Iowa préfigure l’avènement des pionnières comme Yoko Ono, Patti Smith, Lydia Lunch, ou Diamanda Galas et nous tend un piège mortel sur la face B, entièrement consacrée à cette version folle de « Black is the Color of My True Love's Hair ».
Après un premier couplet et quelques minutes classiques, Patty se laisse aller, et sombre dans la démence musicale en hurlant, psalmodiant, et en répétant plus de cent fois le mot « black ». En background, la bande instrumentale n’est pas en reste, avec ce piano massacré à grands coups d’accords plaqués, cette contrebasse malmenée, et autres déviations chromatiques assourdissantes. Sans vraiment se mettre à la colle avec le Free-Jazz, mais en empruntant à Ornette Coleman son vocable discordant et libre, Patty ose le cyanure auditif et offre la version la plus cacophonique et traumatisante de ce standard, la plupart du temps apaisé et mélodieux.
Ecouter ce morceau en entier est une gageure. Si sa longueur peut rebuter au vu des éléments exposés ci-dessus, il reste une expérience unique, dans la même veine que le cathartique « Daddy » de KORN qui lui aussi se laissera aller à la thérapie musicale par les cris.
Encore faut-il pouvoir supporter ces dissonances et ces déchirements. Mais alors qu’elle n’a pas encore 20 ans, la jeune Patty WATERS défie déjà les normes et les coutumes, et semble prophète d’une avant-garde qui ne tardera pas à exploser dans l’underground, et qui la remerciera à grands coups d’hommages, de citations et de reprises. Mais grâce à elle, au milieu de l’été ensoleillé et euphorique de 1966, la noirceur avait trouvé son hymne. Ainsi soit-il.
11 - JOHN FRUSCIANTE - « Enter A Uh » (Smile From The Streets You Hold, 1997)
Le Rock que cela vous amuse ou non, a connu bien des muses tout du long. Depuis son émergence dans les années 50 sous sa forme la plus pure, jusqu’aux déformations du nouveau siècle, le Rock aura chanté les femmes, la vie la nuit, la route, les fans, les concerts, les fantasmes, la tristesse, la dépression et la paresse. Et des STONES aux LIBERTINES, du VELVET aux RED HOT, la drogue aura occupé une place centrale dans sa mythologie, comme une déesse antique aux mauvaises intentions, vous propulsant vers le ciel avant de vous faire chuter pour de bon.
Mais si la drogue, sous toutes ses formes (hash, cocaïne, meth, crack, héroïne, LSD…) a beaucoup inspiré les musiciens, c’est tout simplement parce qu’ils sont nombreux à être tombés sous son charme, et en avoir consommé plus que de raison. Si Ozzy, Iggy Pop, Alice Cooper ou Keith Richards auraient dû affronter la mort bien avant sa date réelle , si la génération Ken Kesey a vanté les joies des acides lysergiques au point de se croire à Katmandu en pleine rue new-yorkaise, les années 80 et 90 n’ont pas été de tout repos, et pas seulement à cause du chômage ou de l’ambiance morose.

Ainsi, John FRUSCIANTE, connu comme le guitariste essentiel des RED HOT CHILI PEPPERS, a lui aussi traversé des périodes traumatiques, tout comme son camarade Anthony Kiedis. La différence, est que John, en créatif ultime, a largement documenté cette période de sa vie, sombre, durant laquelle la dépression et l’addiction s’affrontaient en permanence, le plongeant dans un état de tristesse extrême et le transformant en épave.
John FRUSCIANTE a connu trois périodes bien distinctes au sein des RHCP. Guitariste du quatuor entre 1988/1992, 1998/2009 et de 2019 à aujourd’hui, il a effectué de nombreux allers et retours qui ont quelque part été conditionnés par son état mental et physique. Mais c’est alors qu’il faisait toujours partie du groupe entre 1988 et 1992 qu’il s’est mis à composer pour lui, guidé par ses névroses, sa paranoïa, et sa consommation d’opiacés monstrueuse.
Les néophytes seront sans doute impressionnés par la quantité astronomique d’albums en solo publiés par le chanteur. Mais s’il en est deux qui sont restés gravés dans l’histoire, ce sont bien Niandra LaDes And Usually Just A T-Shirt et Smile From The Streets You Hold.
Pour plusieurs raisons, bonnes d’ailleurs. La première, parce que John les a fait retirer de la vente après son retour au sein des RED HOT en 1998 (depuis, Niandra LaDes And Usually Just A T-Shirt a connu plusieurs rééditions). La seconde, parce que Smile From The Streets You Hold est toujours bloqué à la demande de son concepteur, s’échangeant contre des sommes confortables sur la toile. La troisième enfin, parce qu’ils sont virtuellement inécoutables.
A la manière de John LENNON qui gravait ses traumas sur vinyle en 1970 après une thérapie entreprise avec le docteur Janov, John a pendant quelques années fixé ses états d’âme dans ses veines et sur bande, d’où cette sensation de document-vérité si cher à la Nouvelle Vague française qui se dégage de ses disques. Et pour s’en rendre compte, rien de plus simple. Il suffit de jouer la première piste de Smile From The Streets You Hold et de tenter d’aller jusqu’à son terme.
Too high it can't be we are
Higher can't be we are
Higher can't we are, ou
Higher can't be we are.
Cet album, de sa pochette à sa production ressemble terriblement à une démo enregistrée dans un état second, et est d’une tristesse sans fond. Caractéristique de ce que John ressentait au plus profond du puits dans lequel il était tombé, « Enter A Uh » est déconstruite, tourmentée, déchirante, mais surtout, parfaite transposition de l’état lamentable dans lequel un musicien peut se retrouver après avoir cédé aux sirènes des drogues les plus dures.

John ne chante pas sur ce titre. Il hurle, gémit, pleure, trafique sa voix, le tout sur fond d’instrumental nu à la Hendrix en répétition. Sorte de Post-Blues addictif et terrifiant, « Enter A Uh » propose les huit minutes les plus crues consacrées à la drogue et son cortège de paranoïa, et reste à ce jour l’un des titres les plus effrayants produit par le Rock sous perfusion critique.
L’album n’est évidemment pas à conseiller aux oreilles les moins averties, encore moins aux fans superficiels des RED HOT qui aimeraient jeter une oreille sur le travail solo d’un des membres. Même rompu à l’exercice de l’Outsider Music la moins consensuelle, Smile From The Streets You Hold reste une épreuve difficile, tant le concept est bordélique, le propos chaotique, et la douleur cathartique. Heureusement, John va beaucoup mieux depuis. On évitera par correction de le remercier pour avoir enregistré la meilleure thérapie inversée de l’histoire du Rock (cet album vous dégoûte à tout jamais des drogues, faites-moi confiance), mais on prendra en compte sa contribution comme l’une des plus sincères et tétanisantes jamais publiées.
12 - DEADSY - « Itty Bitty Titty Girl » (Commencement, 1999)
DEADSY est un groupe totalement à part sur la scène Metal/Alternatif Industrielle américaine. Fondé en 1995 par Elijah Blue Allman (le fils de Cher et Gregg Allman), il se définit par une approche assez singulière, que le groupe qualifie lui-même d’Undercore. Sans vraiment savoir ce que le terme peut signifier en dehors du cénacle, il faut reconnaître que la vision d’Elijah Blue Allman est assez unique, et bien loin de MINISTRY, FILTER, NINE INCH NAILS, ORGY ou autre représentant contemporain de la scène électronique.
Admiré par Jonathan Davis qui les signera pour un album, DEADSY est un exemple assez intéressant de l’adéquation entre la musique et le look, et ses trois albums méritent un intérêt particulier, spécialement Commencement, le second. Mais l’affaire qui nous intéresse est plus complexe qu’il n’y paraît au prime abord, puisque le titre incriminé ne fait pas vraiment partie de la discographie du groupe, en tout cas pas celle officielle distribuée par les grandes chaînes.
Elijah Blue Allman s’est un jour déclaré fasciné par la p*dophilie, mais envisagée sous le point de vue d’un serial-killer. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le leader ait signé un titre comme « Itty Bitty Titty Girl » qui en est quelque sorte une apologie relativement malsaine. Le morceau en lui-même détonne dans le répertoire de DEADSY. Dansant, sautillant, il évoque plus les SCISSORS SISTERS que SPINESHANK ou GRAVITY KILLS, et ressemble à une comptine de dancefloor pour école primaire dépravée.
Et une fois encore, c’est ce fameux décalage entre le son et les mots qui frappe. Car si le morceau est indéniablement catchy, il n’en cache pas moins un texte particulièrement ignoble, rendant l’ensemble assez effrayant. Rien que le premier couplet suffit à situer le point de vue :
Oh itty bitty titty girl where are you
Oh itty bitty titty's our love was true
Oh my itty bitty titty so young and so unused
La tournure « so young and so unused » est de fait particulièrement borderline, et place les débats en terrain sensible. Est-il possible d’utiliser un sujet aussi grave pour en faire une chanson aussi légère, sans franchir la frontière séparant la provocation du mauvais goût ? La réponse semble évidente pour le groupe, mais pas tant que ça, puisque le morceau n’est disponible que sur une seule version de l’album, en piste 13, sortie en 1999.

Le morceau a fait le tour d’Internet avec les années, et incarne avec un certain détachement cette vague de provocation juvénile qui a toujours été l’apanage du Rock depuis sa création. Du « Oh she was just seventeen, you know what I mean » des BEATLES sur le premier morceau de leur premier album, jusqu’au « Well I don't care if you're just thirteen » sans équivoque de Ted NUGENT, la thématique de la Lolita si chère à Nabokov et aux japonais obsédés par les culottes (pas si) blanches et les socquettes a souvent été utilisée comme controverse dans le monde du Rock n’Roll.
« Itty Bitty Titty Girl » n’est pas plus condamnable qu’une autre dans ce domaine, quoique ses vers crispent quelque peu les muscles et donnent envie de mettre une bonne claque à l’auteur :
So itsy bitsy titsy
Now you’re off to camp
But I bet
Those itty bitty undies still are damp
I’ll be waiting for September
In the playground outside your class
Comme vous le constatez, le vice est élevé au rang d‘art majeur, ce qui peut provoquer un schisme entre les intentions clairement provocatrices et le fond de pensée. Ainsi, Elijah Blue Allman a souvent été considéré comme un p*dophile à cause de cette chanson, ce qu’il n’est assurément pas. Mais il a tendu le bâton pour se faire battre, en ajoutant à la fin du morceau des rires de petites filles, victimes consentantes selon l’ambiance développée…ce qui est bien évidemment impardonnable.
Tout ceci et cela contribue à faire de cette chanson un sommet de mauvais goût, encore aujourd’hui. D’autres titres de ce dossier se sont penchés sur le même thème, et une fois leur cas évoqué, « Itty Bitty Titty Girl » vous paraîtra presque inoffensive et ludique à côté.
13 - THE GOLDEN PALOMINOS - « Holy » (Dead Inside, 1996)
THE GOLDEN PALOMINOS est un projet monté par Anton Fier en 1981, avant-gardiste, Ambient, bruitiste, Art Rock, Lounge, Acoustic, Dub, Trip Hop selon les albums, et auquel ont participé des pointures comme Bill Laswell, John Zorn, Amanda Kramer ou encore David Moss. Il est très difficile de classer l’œuvre de ce groupe qui n’en était pas vraiment un, mais il est à l’inverse très facile d’être absorbé par ces climats en perpétuel mouvement, et par ces recherches sonores abstraites ou au contraire, très réalistes.
Mais nous allons nous intéresser aujourd’hui à l’un des derniers albums du projet, Dead Inside, publié en 1996 avant un long hiatus de quinze ans. A grosse dominance Illbient (jeu de mots entre le mot ill, un argot issu de la scène hip-hop, expression positive pour exprimer la folie et l'Ambient), Dead Inside est une (presque) épitaphe intéressante pour la carrière prolifique de THE GOLDEN PALOMINOS, et cache en son tracklisting l’un des morceaux les plus terrifiants du genre, le très mal nommé « Holy ».
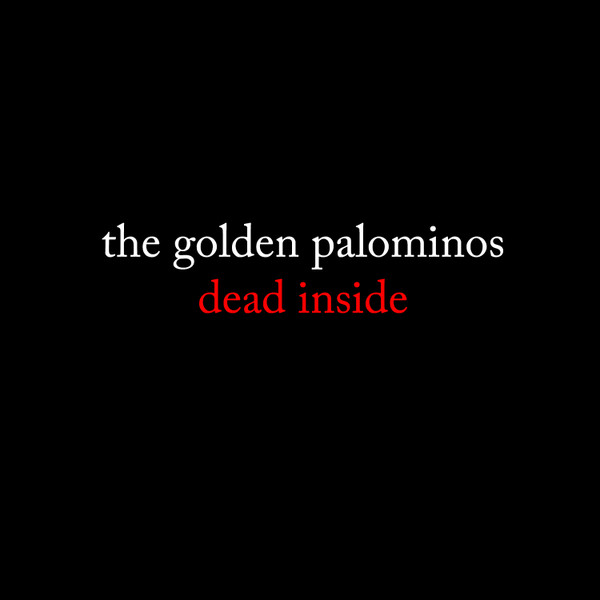
Si vous vous êtes intéressé au monde de la mode à un moment donné de votre vie, vous avez peut-être vu Regardez-moi Disparaître, ce documentaire terrible consacré au modèle et actrice Isabelle Caro, qui à la fin de sa vie ne pesait plus qu’une trentaine de kilos, état du à l’anorexie dont elle était victime depuis l’enfance. Ce documentaire implacable stigmatisait le monde de la mode et ses diktats de maigreur, cette fameuse « taille 0 » que les mannequins femmes doivent atteindre pour pouvoir prétendre défiler pour les plus grands créateurs.
Ces images terribles sont restées gravées dans ma mémoire depuis, tout comme cette campagne de sensibilisation qui alerta les consciences en 2007. On y voyait Isabelle poser nue, dans toute la maigreur de son être, comme une victime des camps de concentration, substitués ici par un déséquilibre mental grave.
« Holy » aurait pu être écrit par Isabelle Caro justement. Sur un fond Trip-Hop neutre mais presque Noisy, se posent des mots terribles, long poème macabre récité par une voix féminine atonale.
I eat only sleep and air
And everyone thinks I'm dumb
But I'm smart because I've figured it out.
Il est très éprouvant d’écouter ce titre, sans avoir envie d’appuyer sur la touche stop. Véritable démence mise en musique d’un personnage pas si fictif que ça, « Holy » défie de ses mots la logique des hommes, et cherche le divin dans l’oubli de soi, la solitude et le dégoût de l’être. Et il y a en effet quelque chose de sacré dans cet acte de déconstruction absolue, comme si la maigreur du corps entraînant la pureté de l’âme.
Starvation is sacred and I scratch my bones
Against the windows at night.
I light candles and feel myself evaporate.
This body is a little church, a little temple.
You can't see me now because I've gone inside.
Ce titre, complètement disharmonique et presque évanescent évoque à merveille la transition entre un corps de femme et un fantôme qui erre dans sa propre prison, isolé de tous, et attendant cet instant magnifique où le corps deviendra si fin qu’il sera transparent. On se souvient du mouvement pro-Ana sur Internet, qui glorifiait l’anorexie, avec ces adolescentes s’échangeant des photos de leurs côtes, de leurs jambes trop fines et de leur torse sans formes. Déclarés illégaux dans la plupart des pays, ces forums ont acquis une indéniable popularité dans les années 90/2000, trouvant un écho chez les adolescentes mal dans leur peau, et désireuses de reprendre le contrôle de leur propre corps, la seule chose qu’elles pouvaient encore prétendre s’approprier dans une société qui les transformait en objets.
Et le dernier couplet de « Holy » est aussi magnifique qu’il n’est terrifiant :
One day when I am thin enough
I'll go outside
Fluttering my hands so I can fly
And I will be so slight that I will pass through all of you
Silently, like wind.
Pour des parents ayant vécu cette triste expérience avec leur enfant, ou bien des femmes ayant traversé une douloureuse période d’anorexie avant de s’en sortir, « Holy » est tout bonnement un miroir tendu vers le tragique, ou bien les mots les plus justes pour décrire un état mental biaisé où la réalité est distordue par la douleur et les complexes. Toujours est-il que cette chanson est tétanisante, comme une mort lente fixée sur bande, docu-drama audio d’une disparition physique derrière le miroir de l’horreur.
Every day I get a little closer to vanishing.
Some days I can't stand up because the room moves under my feet
And I smile because I'm almost there,
I'm almost an angel.
Niveau -2 - Le Parking Condamné
14 - UGK - « Pregnant Pussy » (Banned EP, 1992)
Homophobie, transphobie, misogynie, violences domestiques, haine de la police, de l’autorité en général, d’une bonne partie de la population blanche, quotidien carcéral, défiance entre gangs, drogue, alcool, fêtes orgiaques, street credibility, survêtements, classe en collier mastoc, rimes riches en répétition, mais aussi réalisme social, revanche sur l’histoire, dénonciation des inégalités, provocation au FBI, le Rap et le Hip-Hop sont tout ça, et beaucoup plus bien sûr. Ne réduisons pas le style à ses représentants les plus disgusting, ces deux styles n’en faisant presque qu’un ont enrichi la musique moderne en donnant la possibilité aux jeunes de s’exprimer sans avoir besoin de label, de studio, de manager.
En tant que grand fan du genre, et spécialement de ses racines US des années 80/90, via PUBLIC ENEMY, RUN DMC, NWA, LL COOL JR, je suis le premier à prendre la défense créative des rappeurs qui osent souvent dire tout haut ce que les autres craignent tout bas. Mais il faut admettre que s’il est un style qui véhicule la pire image des femmes, c’est bien le Rap.
Je ne vais pas m’amuser à citer ici tous les morceaux du cru qui parlent des femmes de manière plus que triviale et insultante. Entre le « A Bitch Iz A Bitch » des NIGGERS WITH ATTITUDE, et le cultisme « B*tches Ain't Sh*t » de Dr. Dre et Snoop Dogg, la liste est beaucoup trop longue, et quasiment impossible à reproduire de façon exhaustive. Néanmoins, certains exemples méritent d’être cités, ne serait-ce que pour leur mauvais goût revendiqué, assumé, et qui provoque même la fierté.
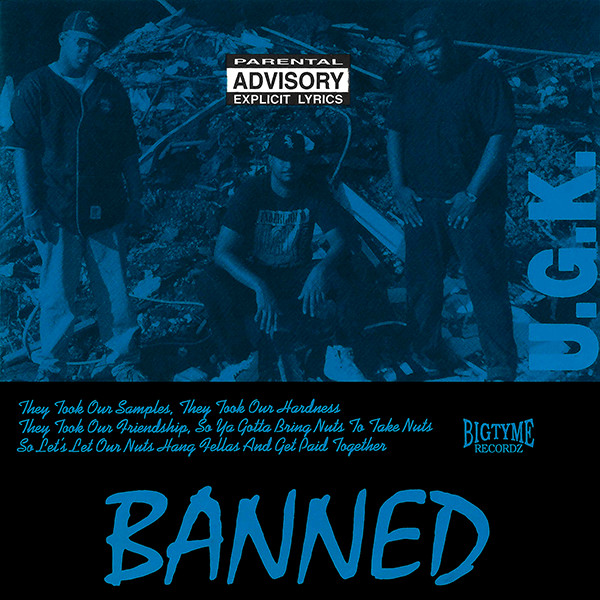
A ce petit jeu de même pas dupes, les texans d’UGK tiennent le podium, sans forcer. Pimp C et Bun B., les deux « têtes pensantes » du groupe n’ont rien à envier aux cadors du Gangsta Rap naissant, du point de vue de la phallocratie s’entend. Si déjà en 1992, les femmes en avaient pris pour leur grade, à tous les niveaux, elles se sont vues donner le coup de grâce par un simple EP du duo, très judicieusement baptisé Banned.
Tu m’étonnes.
Comme le titre le laisse entendre, « Pregnant Pussy » parle délicatement des femmes enceintes, en évoquant par moult métaphores poétiques ce processus de don de vie, ce miracle de l’amour, et la figure christique de la mère (gaïa). Tout est dans le non-dit, les allusions, la rhétorique, et ce titre pourrait servir d’hymne aux baby-showers américaines les plus conservatrices.
Mais bien sûr.
Non, évidemment, ce titre est non seulement un summum de mauvais goût dans le mépris absolu affiché pour les femmes, qui ne sont rien d‘autre que des sal*pes, des p*tes, des trâ*nées, réduites aux parties les plus charnelles de leur anatomie, et à leurs orifices qui constituent leur seul intérêt pour bon nombre de rappeurs. Mais à la manière d’un A Serbian Film, « Pregnant Pussy » va encore plus loin que la concurrence, en tâtant du fameux et infâme « Newborn Porn » qu’on découvrait avec horreur dans le film de Srdjan Spasojevic.
Même pour 1992, le texte ne s’embarrasse pas de principes, et commence directement par son refrain immonde :
Preg-pregnant pussy is the best you can get
Fucking a bitch while her baby sucking dick
I got your fat pregnant bitch in my waterbed
And I'm 'bout to bust a nut on your little baby's head
Un peu plus loin, on s’enfonce (sic) dans le bon goût, grâce à ces deux vers emprunts de tendresse et de respect pour la maternité :
Now if she got a boy, it ain't fun
But if she got a girl, then it's two pussies for the price of one
Inutile de tout dévoiler en détail, je pense que vous avez compris le principe. Ce titre pose le problème de la provocation gratuite, phénomène qui est loin de ne toucher que le Rap US évidemment. Avec encore en exergue une thématique Ô combien réductrice et imbuvable, UGK soulève un lièvre sans le vouloir, et pose le débat de la limite de l’art et de son détachement en cas d’exagération impardonnable. En baptisant son EP Banned, le groupe s’est donc plus ou moins protégé, s’abritant derrière le paravent de la provocation ultime et du 1er amendement pour justifier de ses textes condamnables. Misogynie et p*dophilie faisant visiblement bon ménage, les deux acolytes sont allés au bout de leur sujet - si j’ose dire - et ont de fait percuté de plein fouet le mur de l’indécence.
On peut passer outre un morceau un peu dur dans la veine de « Brigitte, Femme de Flic », ou encore « Just Don't Bite It », mais le malaise provoqué par « Pregnant Pussy » est si tangible qu’on se représente la scène sans l’avoir jamais vécue. De là, il est inutile d’attendre une absolution qui ne viendra jamais, et l’art quitte la scène sous les huées d’une audience masculine si complaisante avec ses artistes du même genre. Beurk.
15 - DIAMANDA GALAS - Plague Mass (1991)
Pour cette entrée et cette artiste, je ne vous propose pas une simple chanson, mais un album entier. J’aurais pu piocher dans un répertoire conséquent pour y dénicher la perle la plus sombre et glaçante, mais rien n’est comparable à l’intensité éprouvée à l’écoute de ce live de plus d’une heure, pendant laquelle la diva casse tous les codes et franchit toutes les limites.
Vous êtes nombreux à connaître Diamanda GALAS, la prêtresse de l’avant-garde, la reine du lyrisme morbide. D’origine grecque par ses parents mais née et élevée à San Diego, Diamanda a commencé sa carrière par le piano, jouant avec Mark Dresser ou Butch Morris, avant d’incarner le premier rôle de l’opéra Un jour Comme un Autre au festival d’Avignon en 1979. Mais ce sont évidemment ses albums, cryptiques, horrifiques, engagés et perturbants qui ont fait sa légende.

En 1990, Diamanda GALAS a déjà quelques exploits à son actif. Fille illégitime de La Callas et Patty Waters, elle a secoué l’underground via le mythique label Mute (qui l’accompagnera jusqu’en 2007), et ses exactions studio ont déjà fait le tour d’une faune interlope envoutée par ses quatre octaves et son chant halluciné et incomparable. Mais si des œuvres comme Saint of the Pit ou The Divine Punishment ont salement secoué les bases de l’avant-garde classique, rien ne l’a préparée à cette messe en sang majeur que fut Plague Mass.
Performance donnée à la Cathédrale St.John the Divine à New-York les 12 et 13 octobre 1990, Plague Mass est une messe mortuaire donnée en mémoire des victimes du SIDA, et dénonçant l’inaction des pouvoirs publics et la morale de l’Amérique la plus puritaine qui a vite classé ce virus sur les étagères des punitions divines bien méritées.
Diamanda, atteinte d’hépatite C, a commencé à chanter à propos du virus HIV en 1984. Sa trilogie Masque Of The Red Death (qui comprend les trois albums Saint of the Pit, The Divine Punishment et You Must Be Certain Of The Devil) se veut description de la souffrance des patients atteints de cette affliction, qu’elle connaît bien, puisque son frère, le dramaturge Philip-Dimitri Galás en est décédé juste avant qu’elle n’ait eu le temps d’achever cette trilogie.
L’hypocrisie de l’église et des pouvoirs publics poussera la chanteuse à rejoindre les activistes d’ACT UP, et à se faire arrêter. Mais cela ne la bridera évidemment pas, et c’est en grandes pompes qu’elle présente Plague Mass au public incrédule de New-York.
Diamanda a facilement admis quelques influences au cours de sa carrière. Maria Callas, Annette Peacock, Patty Waters, John Lee Hooker, Johnny Cash, Ray Charles, ou Jimi Hendrix, ce qui a pu se sentir sur quelques-uns sur ses albums. Mais Plague Mass la fait passer à un stade encore supérieur, presque christique inversé, et les dix psaumes de cette messe transfigurent la souffrance et la condamnation, à l’image de l’artiste, qui se présente sur scène le torse nu et maculée de sang.

Le visuel est choc, mais le propos artistique l’est encore plus. A l’image de Patty Waters, l’une de ses muses et son College Tour de 1966, Diamanda sublime l’exercice du live, et nous entraîne sur un chemin de croix parsemé de douleurs, de jugements, d’ostracisme, de condamnations et de sons irritants, provocants, dissonants et assourdissants.
N’ayons pas peur de dire que Plague Mass est l’une des performances les plus intenses de la musique moderne d’avant-garde influencée par le classique et l’opéra. Cette messe est d‘ailleurs un opéra maudit joué par des victimes, contaminées par l’ignorance, condamnées par l’indifférence, auxquelles Diamanda offre une tribune, au sein même d’une cathédrale pour condamner la position sans équivoque de l’église.
En se replaçant dans le contexte politique et social de l’époque, l’écoute exhaustive de ce live est une expérience hors du commun qui exige une discipline mentale infaillible et une certaine dose de résistance à l’épreuve des hululements, de l’agonie vocale, et de la transfiguration d’un état physique qui s’approche assez près de l’épreuve christique. Rarement disque n’aura été à la hauteur de son concept. Diamanda n’interprète pas, elle incarne, elle ne joue pas, elle vit, elle ne chante pas, elle hurle de douleur. Encore aujourd’hui, alors que les traitements permettent aux séropositifs de vivre une vie à peu près normale, la souffrance dégagée par ce disque reste le témoignage le plus troublant d’une époque de peur et de stigmatisation. Et l’incarnation la plus concrète de l’horreur de la maladie, telle que l’ont connue les infortunées victimes de cet holocauste moral.
16 - KRYSZTOF PENDERECKI - « Threnody to the Victims of Hiroshima » (1959)
Tren ofiarom Hiroszimy (en français Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima, la thrène étant dans la Grèce Antique une lamentation funèbre chantée lors de funérailles) est une pièce longue de plus de huit minutes de Krzysztof Penderecki, compositeur polonais (né le 23 novembre 1933), en hommage aux victimes d’Hiroshima. Cette pièce classique a reçu de nombreux prix de par le monde, propulsant le jeune Krzysztof sous les feux de la rampe.
Il est assez difficile d’imaginer qu’un compositeur puisse consacrer une telle pièce à un évènement aussi tragique, et surtout, aussi loin de son pays. Il est encore plus difficile - lorsqu’on ne connaît pas le morceau - d’imaginer qu’il correspond note pour note, silence pour silence, discordance pour discordance à la mort de centaines de milliers de personnes, sous les feux d’une bombe atomique. Mais l’aventure de cette composition avait commencé sous des auspices bien différents. A la base, Tren ofiarom Hiroszimy fut baptisée 8’37, de par sa durée, et son auteur explique la transformation qui aurait pu ne jamais avoir lieu :
[la pièce] n'existait que dans mon imagination de manière assez abstraite. À la suite de l'enregistrement de Jan Krenz, quand j'ai pu écouter une interprétation vivante, j'étais frappé par la charge émotionnelle de l'œuvre et je trouvais dommage de la condamner à l'anonymat de ces chiffres. J'ai cherché des associations et, finalement, j'ai décidé de la dédier aux victimes d'Hiroshima.

L’intention de départ n’était donc pas de rendre hommage aux victimes du bombardement du 6 août 1945, mais simplement de coucher sur partition des sons qui tournaient dans la tête du compositeur. Grand bien lui a pris de changer son fusil d’épaule.
A la manière de Picasso avec Guernica, Krzysztof Penderecki réussit de façon très concrète à décrire les atrocités de la guerre, et le non-sens humain que représente une bombe atomique lâchée sur une population civile. Alors que les Etats-Unis n’avaient pas encore largué leur napalm sur le Vietnam, ils avaient déjà expérimenté le massacre de masse pour faire plier le genou au Japon, et obliger l’empereur Hirohito à signer la reddition, et accepter les accords de Potsdam.
Cette composition, mêlant musique concrète et bande-originale de film a été conçue pour 52 instruments à cordes (24 violons ; 10 altos ; 10 violoncelles ; 8 contrebasses), et alterne les dissonances, les atmosphères confinées, les éclairs de terreur, la violence du bombardement, et le souffle torride balayant les maisons comme les victimes.

Il est très difficile d’imaginer aujourd’hui ce qu’ont pu ressentir les populations mondiales après le double bombardement d’Hiroshima et Nagasaki. L’évènement, vieux de presque quatre-vingt ans n’est plus qu’un lointain souvenir, et il peut être délicat de se sentir concerné par cette pièce musicale qui elle aussi, appartient au passé. Mais il est très facile au contraire de comprendre pourquoi Krzysztof Penderecki a choisi le thème d’Hiroshima pour illustrer cette composite chiffrée. D’écoute difficile, elle reste un formidable témoignage des atrocités de la guerre, et de sa conclusion apocalyptique. Alors que les Etats-Unis et l’Allemagne se sont livrés à une course à l’armement nucléaire jusqu’à la défaite de l’Allemagne (celle-ci était pourtant très près du but), « Threnody to the Victims of Hiroshima » apporte sans le vouloir un jugement de valeur sur cette absence totale d’humanité, la seconde guerre mondiale ayant déjà fait des dizaines de millions de victimes.
Les possibilités sonores des cordes sont poussées à l’extrême, procurant des sensations sonores inédites. Il n’y a pas de pulsation rythmique, utilisation d'un temps lisse. Il n’y a pas non plus de mélodies mais uniquement des atmosphères, des climats.
Voilà qui résume à merveille ce morceau, long, éprouvant, et totalement arythmique et atonal. Aux antipodes des canons classiques de l’époque, Krzysztof Penderecki s’est presque rapproché d’un Pierre Henry ou d’un Pierre Schaeffer, pionniers de la musique concrète.
En 2023, il reste encore beaucoup de gens touchés par cette œuvre, fréquemment nommée dans les listes des morceaux les plus dérangeants du vingtième siècle. Et quand les atrocités humaines trouvent un écho dans l’art, ce dernier est sans pitié pour les juger. Et les condamner.
17 - MAURIZIO BIANCHI - Symphony For A Genocide (1981)
Six millions de juifs.
La shoah aura fait six millions de victimes juives. Encore aujourd’hui, près de quatre-vingt ans après la fin de la guerre, ce nombre semble surréaliste, et cette période de l’histoire toujours aussi traumatique. Le Mémorial de la Shoah annonce un total de 5 860 000 victimes, arrondi à six en prenant en compte l’absence de registre de certains camps et le flou entourant les exécutions sauvages et les derniers gazages. Cette solution finale prônée par Hitler et exécutée par Himmler a inspiré les arts comme aucune autre période de l’histoire, et a produit des œuvres qui ont tenté de reproduire en sons, images et modelages toute l’atrocité de cette époque.
Il est pourtant difficile de décrire avec acuité toute l’horreur de ces camps de la mort, divisés entre camps de concentration et camps d’extermination. N’oublions pas que plus de deux millions de juifs sont morts exécutés, dans les ghettos, mais pour le plus grand dénominateur commun, ce sont les camps de la mort qui furent les symboles les plus emblématiques de ce meurtre de masse, à une échelle jamais égalée depuis. Ou plutôt si…par Staline et Mao Zedong.
De fait, décrire par des sons l’arrivée des trains de la mort, la séparation des enfants de leur famille, le triage des victimes, et l’envoi dans les sinistres chambres à gaz est une tâche difficile, pour ne pas dire impossible. Mais Maurizio BIANCHI y est parvenu, et de la façon la plus évidente qui soit.
Né en 1955 en Italie, Maurizio BIANCHI s’est très vite illustré comme précurseur de la musique Industrielle, et a lâché rien que pour l’année 1980 pas moins de 13 travaux, la plupart du temps en cassette, utilisant son équipement électronique pour « éveiller les consciences à la décadence moderne ». Véritable pionnier de la musique électronique robotique, il s’est penché en 1981 sur la Shoah et les camps d’extermination, publiant l’inoubliable et traumatique Symphony For A Genocide, qui reste à ce jour l’une des pièces les plus essentielles de la musique Industrielle, au même titre que n’importe quel album de THROBBING GRISTLE ou CURRENT 93.
Mais alors, comment le compositeur s’y est-il pris pour retranscrire l’horreur vécue dans des camps comme Auschwitz, Treblinka ou Sobibor ? De la façon la plus simple qui soit, en produisant des collages sonores mécaniques, robotiques, sans âme, complètement atonaux, et reposant inexorablement sur un rythme régulier. En procédant de la sorte, Maurizio est parvenu à retranscrire la froideur clinique de cette machinerie de mort qui chaque jour, envoyait plus de dix-mille juifs à l’abattoir.

Les sons stridents, les boucles hypnotiques, les récurrences abrasives, tout ici est fait pour suggérer l’automatisme de l’ignominie, et cette façon qu’ont eu les nazis de traiter un holocauste à la manière d’un contremaître imposant le rythme de production dans une usine lambda. Les juifs, réduits à des ombres et des nombres, étaient traités comme des détritus dans une déchetterie, classés, étiquetés, sans aucune humanité, ni le moindre sentiment la plupart du temps.
Généralement, cette thématique est traitée comme un pathos de l’histoire, avec force violons, cordes, textes larmoyants, et autres prières musicales. Ici, l’horreur est décrite avec une régularité sans failles, comme une tâche administrative avec obligation de rendement, et l’effet produit sur l’organisme est énorme. La froideur des sons dépeint avec une acuité insupportable le quotidien d’une machine de mort comme Auschwitz, ses fours crématoires, ses chambres de gazage et ses fosses communes, industrie morbide servant des desseins apocalyptiques.

De fait, le travail accompli par Maurizio BIANCHI est d’importance, et sans conteste possible le plus fidèle au sujet choisi, évitant les atermoiements pour présenter l’ignominie dans toute son absurdité inhumaine. Sons inversés, bruits statiques, fréquences irritantes, le malaise est palpable, et Symphony For A Genocide reste aujourd’hui l’une des œuvres les plus dramatiques de la première vague industrielle.
Eprouvant pour le moins, traumatisant dans la majorité des cas. Mais il fallait en passer par là pour se passer d’images, et peindre un tableau noir et blanc d’une époque de l’histoire où les vies humaines n’étaient plus que des tatouages sur l’avant-bras, et les sentiments de simples excuses pour retarder l’inévitable.
18 - CLASSROOM PROJECTS - « The Lyke-Wake Dirge » (Incredible Music Made By Children In Schools, 1959/1981)
Vous avez remarqué à quel point les films d’horreur mettant en scène des enfants dans le rôle de boogeymen sont les plus effrayants ? Du générique The Children jusqu’au récent et touchant The Innocents en passant par Le Village des Damnés et autre Children of the Corn, l’innocence transformée en cruauté est certainement le ressort dramatique le plus malin utilisé par le cinéma et la littérature, ces charmants bambins étant censés représenter la fragilité même et le manque total de cruauté envers autrui.
En musique, l’affaire est toute autre. Peu d’albums enregistrés par des enfants peuvent prétendre au titre d’œuvre malsaine, et le concept est souvent utilisé comme un gimmick, et non un moyen de transformer une chanson basique en cauchemar éveillé. La plupart du temps, le malaise est instauré par des arrangements, des pleurs en arrière-plan comme sur l’ignoble « The Kids » de Lou REED sur son Berlin (Bob Ezrin avait traumatisé les enfants en leur disant que leurs parents les avaient abandonnés pour obtenir le résultat escompté), ou des rires enfantins qui placés dans le bon contexte suggéraient une incarnation diabolique par de petites têtes blondes faussement inoffensives.
Mais les enfants en eux-mêmes peuvent aussi, en musique, être les acteurs d’un sentiment d’oppression, plus rarement, et le cas le plus parlant est sans doute celui de cette compilation complètement incongrue Incredible Music Made By Children In Schools, sortie de nulle part en 2013.
Editée en vinyle et CD, Incredible Music Made By Children In Schools est comme son titre l’indique, une collection de morceaux joués par des enfants d’école primaire, âgés de 8 à 11 ans, garçons et filles. Les dix-neuf morceaux de l’album sont partagés entre plusieurs groupes, dont le SOUNDS AND SILENCE, qui interprète ce fameux classique Folk anglais « The Lyke-Wake Dirge ».
D’ordinaire, lorsqu’on pense à de la musique jouée dans des écoles, on imagine d’innocents canons, de virginales chorales, des vers ludiques portant sur les choses de la vie, les rêves et les histoires à dormir debout. Des mélodies simples et enfantines, des voix mutines sublimes de naïveté, et certainement pas un instrumental dissonant et macabre, à peine souligné de murmures inquiétants et autres respirations oppressantes.

Il faut dire que le morceau choisi n’induisait pas forcément un traitement lumineux. Après tout, « The Lyke-Wake Dirge » évoque le voyage de l’âme entre la mort et le purgatoire, et la veillée mortuaire qui précède la mise en terre. On a déjà vu plus joyeux à proposer à des enfants n’ayant même pas encore douze ans, et le choix peut sembler plus qu’hasardeux : impensable.
Mais y penser est une chose, et l’entendre en est une autre. Entre la Satanic Mass d’Anton LaVey, « Ces Gens-là » de Jacques Brel, MAGMA et Pierre Henry, Diamanda Galas et Boyd Rice, « The Lyke-Wake Dirge » est une aventure peu commune, et de celles qui laissent des souvenirs étranges dans la mémoire meurtrie. L’instrumentation, complète et régulière comme un métronome, la voix atonale et fantomatique, le rythme lent et processionnel font de ce morceau un horrific short movie pour les tympans, avec en arrière-plan les regards inquiétants d’enfants qui n’en sont plus vraiment que de nom. Du moins à cet instant précis.
Tous les morceaux proposés par le collectif SOUNDS AND SILENCE sont à divers degrés inquiétants et proches de la musique concrète. J’en tiens pour preuve le sombre « Music For Cymbals » ou l’évaporé et religieux « Alleluia ». Mais la thématique de « The Lyke-Wake Dirge », totalement inadaptée à des enfants en bas âge en font l’un des morceaux les plus effrayants de l’histoire de la musique scolaire.
Et si les parents de l’époque attendaient avec impatience une innocente kermesse ou un gentil concert de traditionnels rieurs, autant dire que leur déception et leur désarroi ont dû être à la hauteur de l’horreur improbable de ce morceau parlant de mort, de Purgatoire et de veille funèbre. Une curiosité, pour le moins, et la preuve s’il en était besoin que nos chers bambins peuvent parfois être plus inquiétants que la pire des légendes urbaines.
Niveau -3 - Le sous-sol oublié
19 - SCOTT WALKER - « Clara » (The Drift, 2006)
Si l’on devait décerner la palme de l’artiste le plus versatile de ce dossier, Scott WALKER la gagnerait haut la main sans que personne ne conteste le résultat. Il est en effet incroyable de constater l’écart artistique qui sépare ses premiers albums des derniers, et de mesurer la progression entre des débuts bien sages et une maturité marquée par la grandiloquence et l’avant-gardisme.
Né le 9 janvier 1943 à Hamilton dans l’Ohio sous le nom d’Engel, Scott WALKER a montré très rapidement des signes d’individualisme, se prétendant même « Ennemi naturel des surfeurs californiens » à la fin des années 50. A cette époque, le jeune Scott est passionné par le cinéma européen, mais se débrouille pour jouer de la basse et devenir un musicien de session. Puis il rencontrera le guitariste/chanteur John Maus, devenu John Walker sur scène, adoptera le même pseudo, avant qu’un trio ne se forme à l’arrivée de Gary Leeds. Les WALKER BROTHERS étaient nés.

Carrière intéressante quoi que marquée par les tendances de l’époque, Scott s’offrit une longue parenthèse en solo pour développer son propre style que beaucoup ont qualifié de Pop Baroque. Il est certain que le timbre de sa voix, unique, en faisait un ténor à l’expression stylisée, dramatisant des pop-songs peaufinées à l’extrême sous un vernis Folk. L‘homme connaîtra un succès certain avec ses quatre premiers albums éponymes et chiffrés, et continuera son parcours entre ses exercices en solitaire et les travaux de groupe. Puis un jour, après un long hiatus, le tableau de sa vie artistique changea radicalement de tonalité.
Ce changement fut amorcé en 1984 avec l’album Climate Of Hunter. Alors que les WALKER BROTHERS avaient déjà modifié leur optique sur Nite Flights en 1978 et accepté l’appui de guitares Rock et de fulgurances électriques, Scott décide de ne plus mettre qu’une infime dose d’eau dans son vin pour se rapprocher de sa nature profonde en perpétuelle mutation. Climate Of Hunter brisait alors un silence de dix années, préfigurant un nouveau hiatus d’une décennie supplémentaire. Scott ne vécut toutefois pas comme un ermite entre 1984 et 1995. Il décida simplement d’arrêter de faire de la musique, tout en gardant une vie sociale tout à fait normale…Jusqu’à ce premier incident, sobrement baptisé Tilt.
Tilt prolongeait les expérimentations entamées sur Climate Of Hunter et se voulait collision d’antimatière entre le Rock et la musique classique moderne. Résolument avant-gardiste, avec en support un orchestre complet, Tilt marquait le point de départ de la dernière partie de carrière de WALKER, qui plongea une fois de plus dans les abysses du silence…jusqu’en 2006.

Et bien qu’échaudés par Tilt, les fans découvrirent totalement hagard les options présentées sur The Drift.
The Drift poussa l’expérimentation dans ses derniers retranchements. Le Rock céda sa place à l’Industriel, à la No-Wave, à l’électronique, tandis que le classique moderne occupait toujours une place importante. La voix de Scott, toujours aussi unique, hésitait entre complainte funèbre et vibrato dramatique, donnant corps à des visions apocalyptiques, l’album traitant de la mort, de la maladie, de la torture, mais aussi d’évènements historiques sombres, en adéquation avec une démarche musicale extrême.
Ainsi, dans ce dédale de sons irritants (nous parlons ici de braiement d’âne, d’un Donald Duck démoniaque et d’un percussionniste frappant de toutes ses forces un énorme quartier de viande crue), de progressions obscures et autres traumas labyrinthiques, surnageait une composition tout à fait symptomatique du virage négocié par l’artiste, la bien-nommé « Clara ».
Il est difficile au prime abord de savoir de quoi traite cette chanson. En effet, en bon adepte de paroles cryptiques et indéchiffrables, Scott n’aime rien tant que nous perdre dans une toile de vers figuratifs, histoire justement de cacher l’histoire sous un épais vernis d’abstraction. Mais musicalement, « Clara » incarnait aussi la limite d’une démarche tellement dramatique qu’elle renvoyait la tragédie grecque aux rayons de la pantalonnade éhontée.
Ayant abandonné depuis longtemps les structures de chansons Rock classiques pour se plonger dans la narration de longs poèmes chantés, Scott WALKER nous propose avec « Clara » une véritable descente aux enfers que son timbre de ténor aliéné renforce cruellement, et implacablement.
This is not a cornhusk doll
Dipped in blood in the moonlight
Like what happen in America
De quoi parle donc cette histoire de poupée d'enveloppes de maïs ? Difficile à dire en lisant les paroles de cette chanson, et il fallut la perspicacité de quelques analystes pour finalement savoir que « Clara » abordait la tragédie italienne de la seconde guerre mondiale, et la pendaison post-mortem de Mussolini et sa maîtresse Clara Petacci. Les pistes bien brouillées, allusives à des seins lourds, de longues jambes et cheveux longs et noirs, se voyaient noyées dans un maelstrom de sons graves, comme si David Tibet, Boyd Rice et THROBBING GRISTLE partageaient le festin d’un souvenir macabre de démonstration publique d’affranchissement définitif du fascisme. L’écoute de ce morceau, comme de tout l’album est relativement difficile. Les fulgurances bruitistes le disputent à de longs silences narrés, et le chaos ambiant contraste avec la délicatesse poétique de paroles absconses, faisant de cette longue suite une ode macabre à la mort d’un dictateur et de sa compagne.
A partir de Tilt, une nouvelle génération de fans illustres s’attache à la légende improbable de Scott Walker. Les hommages pleuvront, comme les demandes de collaboration, et Scott continuera son parcours en toute indépendance, loin des canons de production de l’Angleterre ou de l’Amérique des années 90/2000. Mais ces douze minutes et cinquante-trois secondes horrifiques et traumatisantes resteront à jamais gravées dans la chair de la musique moderne, comme un avertissement de temps à venir encore plus troubles que le nazisme, le terrorisme et le fascisme.
The mood soon changed, in the clear morning air
A man came up towards the body, and poked it with a stick
It rocked stiffly, and twisted around at the end of the rope
Un balancement morbide pour un poème cauchemardesque.
20 - FIRST OF THE NINTH CHORUS - « Napalm Sticks to Kids » (1972)
Il y aura peu de choses à dire sur ce classique militaire américain des années 70. Créée en 1972 par les COVERED WAGON MUSICIANS, militaires stationnés sur la base de l’Air Force Mountain Home, « Napalm Sticks to Kids » est en quelque sorte un résumé sans complaisance de la violence de la guerre du Vietnam et son lot d’atrocités. « Napalm Sticks to Kids » fait partie de la famille des military cadences, ces chansons en questions/réponses entonnées durant les marches ou les courses pour galvaniser les troupes. Souvent innocentes et empreintes de patriotisme, elles s’aventurent plus rarement sur le terrain de l’ignominie de la guerre, sauf dans ce cas précis.

FIRST OF THE NINTH CHORUS, ensemble musical militaire en propose la version la plus connue, enregistrée live au début des années 70. Et c’est encore une fois le décalage entre le fond et la forme qui la transforme en épitomé d’horreur, collection de vignettes atroces consacrées aux exactions commises au Vietnam.
A ce titre, le texte ne laisse aucunement place à l’interprétation. Sur fond de Folk Song innocente et entraînante, se cache donc l’un des morceaux les plus horribles de l’histoire des Etats-Unis, et ses mots résonnent encore, souvent interprétés de travers comme la glorification de la violence et la barbarie de la guerre.
We shoot the sick, the young, the lame
We do our best to kill and maim
Because the kills all count the same
Napalm sticks to kids
Napalm sticks to kids est donc le leitmotiv de cette chanson, intervenant régulièrement à la fin de chaque couplet, comme un mantra récité par des soldats désabusés par la brutalité constante d’un conflit qui les dépasse. Si beaucoup ont pris ces mots au pied de la lettre, pensant que des soldats barbares ressentaient le besoin de s’exprimer artistiquement quant à leur comportement sans pitié, la majorité a évidemment compris que cette chanson tout sauf innocente était une condamnation sans appel des traitements réservés à la population vietnamienne durant le fameux conflit qui s’est étalé sur une quinzaine d’années.
Tout y passe, les décapitations, les exécutions sommaires, l’utilisation d’armes chimiques, et les images utilisées sont d’une atrocité sans nom. Ainsi, le couplet suivant prodigue une astuce imparable pour descendre plusieurs enfants d’une rafale de mitrailleuse :
Attack some kids when you go downtown
By throwing some candy on the ground
Then grease 'em when they gather 'round
Napalm sticks to kids

Toute la chanson n’est qu’un catalogue d’atrocités et de plaisanteries douteuses sur les massacres engendrés par ce conflit unique dans les annales de la guerre. Et même en comprenant le caractère de dénonciation de ce morceau, on ne peut s’empêcher d’être mal à l’aise durant son écoute, les images d’enfants brûlés revenant à la surface de la mémoire pour le pire de l’histoire. Le napalm étant l’arme emblématique de cette guerre entre les Etats-Unis et le Vietnam communiste, son utilisation dans une chanson de marche n’en est que plus malsaine.
Shootin’ women’s lots of fun
Try killin' one that’s pregnant, son
You'll get two for the price of one
Napalm sticks to kids
Plus de cinquante ans après sa création, « Napalm Sticks to Kids » reste un classique du patrimoine américain qui sera chanté jusque dans les années 80 sur les bases militaires américaines. On imagine avec peine comment des soldats pouvaient se sentir motivés par de telles paroles, et même pris au second degré, les vers de « Napalm Sticks to Kids » sont parmi les rimes les plus atroces de la légende militaire américaine.
21 - ANTON LAVEY - The Satanic Mass (1968)
Les liens entre la religion et la musique sont étroits. Au vingtième siècle, les différents cultes ont tous eu une large distribution discographique, pour propager la bonne parole au-delà d’un cercle de fidèles. Negro spirituals, gospels, cantiques, messes, prêches, toutes les formes de prières et d’hommages sont devenus disponibles en vinyle, cassette, livre/disque, puis CD, mp3…Il est évident que la qualité artistique de nombre de ces produits est plus que limitée, et l’existence de certains témoignages fervents fleurissent aujourd’hui dans les tops consacrés aux pochettes les plus atroces et/ou aux titres les plus équivoques. Mais s’il est un enregistrement qui a conservé tout son pouvoir aujourd’hui, c’est bien le mythique The Satanic Mass d’Anton LAVEY.
Howard Stanton LEVEY, devenu Anton Szandor LAVEY, est né le 11 avril 1930 à Chicago. Il est le fondateur de l'Église de Satan et l’auteur de l'ouvrage La Bible satanique, publié en 1969 et traduit en français en 2006. Mais il est aussi connu pour avoir enregistré en 1969 une véritable messe satanique, éditée ensuite par le label Murgenstrumm. D’abord pressé à 1875 exemplaires, il fut réédité à hauteur de 1000 copies/an les trois années suivantes.
The Satanic Mass est donc l’équivalent audio de la bible de LAVEY, et se veut témoignage de la puissance de l'Église de Satan à la fin des années 60 (depuis sa création en 1966). A l’époque, l’occulte est en plein boom, et de nombreux hippies, outcasts, marginaux, mais surtout des acteurs, chanteurs, vedettes diverses et plus ou moins fraîches, adhérent aux théories de l’Eglise de Satan, qui prône des valeurs en totale adéquation avec son époque. Si le satanisme a souvent été dépeint de façon caricaturale, avec ses prêtres/fidèles/ministres encapuchonnés, arborant d’énormes colliers en forme de pentagramme, et sacrifiant une vierge à la bougie au plus profond des forêts, celui pratiqué par LAVEY n’est rien de plus qu’une célébration de l’hédonisme le plus absolu, avec pour vertu cardinale l’égoïsme et les plaisirs charnels et terrestres.
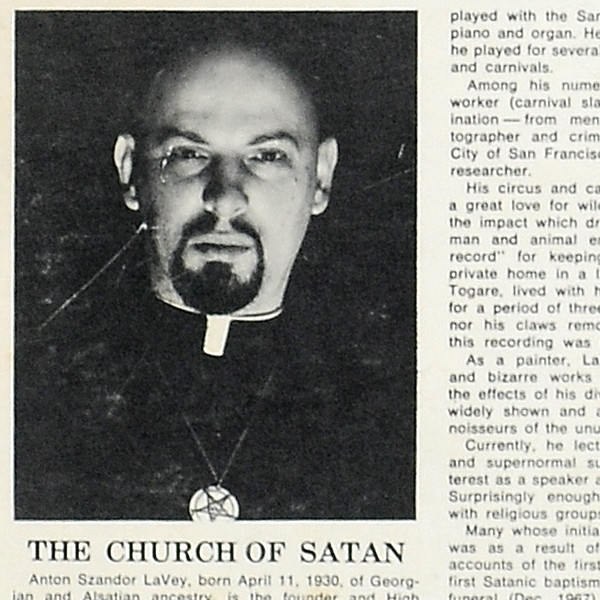
Tout ceci est évidemment bien innocent. Après tout, les théories de LAVEY ne sont rien de plus qu’une incarnation pseudo maléfique des travers humains les plus fréquents dans le milieu californien de l’époque, mais dans le marasme de la fin de l’âge d’or des sixties, entre Altamont et les meurtres de Cielo Drive par la famille Manson, il prend une tournure assez funeste, renforcée par une musique processionnelle, jouée à l’orgue par LAVEY lui-même.
Ecouté en 2023, The Satanic Mass ressemble à la B.O d’un film d’horreur des années 60/70, avec ses longues plages de narration soutenue par cet orgue fantomatique, une sorte de transposition des films les plus sombres de la Hammer, avec en petit plus, cette aura de mystère qui planait sur l’organisation. Beaucoup de stars se sont revendiquées de l’Eglise de Satan, dont MARILYN MANSON ou KING DIAMOND, et lors de ses années d’activité, Anton fut souvent sollicité en tant qu’expert en occulte sur le plateau de certains films.
Il n’empêche que l’importance de cet enregistrement ne saurait être remise en cause. La religion chrétienne ayant inondé les bacs des disquaires, mais aussi les tribunes publiques à grands coups de prédicateurs, de messagers divins et autres manifestations terrestres de la force suprême, The Satanic Mass oppose un contre-argument intéressant, et radicalement inverse aux convictions de nombreux chrétiens de par les Etats-Unis, spécialement au Sud.

Se plonger dans ce disque est une expérience hors du commun. Si le tout a vieilli, si les sonorités d’orgue semblent désuètes, l’album peut plonger dans le malaise, et sembler l’écho d’une utopie hippie mise à mal par la réalité et la violence de la guerre du Vietnam, d’Hollywood et des relations internationales avec la Russie. Les « Hail Satan » repris collégialement, les notes les plus sombres de l’orgue qui affrontent des carillons, tout contribue à faire de cet enregistrement l’un des témoignages les plus étranges du vingtième siècle, et si LAVEY, décédé en 1997 incarne aujourd’hui l’image d’Epinal de la décadence californienne de la fin des sixties, le pouvoir de The Satanic Mass fascine encore bien des auditeurs de nos jours.
On peut trouver des hommages au père fondateur de l’Eglise de Satan dans bien des films, mais sa bible satanique n’a jamais reçu plus bel hommage que dans La Neuvième Porte de Roman Polanski. Dans ce film, elle est plus ou moins remplacée (au même niveau que le Nécronomicon) par un ouvrage nommé Les Neuf Portes du Royaume des Ombres écrit par Aristide Torchia, dont l’aristocratie internationale se repaît lors d’orgies de chairs fatiguées et de comptes en banque trop chargés.
Délicatement vintage, cet enregistrement possède son charme, notamment dans sa seconde partie, plus musicale, et ressemblant parfois à un score de film à gros budget.
Hail Satan !
22 - ZERO KAMA - « Town Of Pyramids (Night Of Pan) » (The Secret Eye Of L.A.Y.L.A.H., 1984)
Michael Sperlhofer aka Michael DeWitt, est un membre de la scène rituelle/industrielle des années 80, mais aussi le fondateur du label Nekrophile Rekords, qui comme son nom l’indique, ne distribue ni Pop, ni Eurodance. Michael a aussi acquis une réputation de traducteur d’ouvrages occultes pour les éditions Ananael. Mais le projet qui nous intéresse aujourd’hui est l’une de ses plus anciennes incarnations, sous le nom de ZERO KAMA.
Seul enregistrement connu de ce concept, The Secret Eye Of L.A.Y.L.A.H. est un disque hautement expérimental, entre Drone, Noise, musique concrète et Industrielle. Entièrement instrumental, il a été composé et enregistré du 5 au 28 mai 1984, et seulement édité en cassette la même année. Ce concept album est dévoué au symbolisme de L.A.Y.L.A.H., soit la nuit et la mort, mais aussi à son équivalent numérique Oz, une puissante force sexuelle de la création, qui soulève l’identité des deux forces basiques opposées de l’univers, dans lequel les amants trouvent l’extase en Pan.
Evidemment, ce concept semblera abscons à tous ceux étrangers à cette mythologie - ce qui est mon cas - mais là n’est pas l’intérêt de cet album unique en son genre, et ce, pour plusieurs raisons.
La première étant son contenu et sa valeur artistiques. Entre musique tribale, Industriel hypnotique, musique minimaliste et Noise plein de sens, The Secret Eye Of L.A.Y.L.A.H. à une gigantesque valeur musicale, comme en témoigne la diversité des pistes proposées. Et si je me propose de vous faire découvrir aujourd’hui sa conclusion, c’est qu’elle fait partie des inserts les plus sombres de cet album.

« Town Of Pyramids (Night Of Pan) » n’est pas la composition la plus effrayante de cette liste. Toutefois, ses arrangements, ses respirations étranges et ses sons tournoyants comme des doigts effleurant le cristal en font une incantation étrange, mystique, entre communication globale et langage secret parlé uniquement par les initiés. A contrario de bien des personnalités gravitant dans le monde de la musique Ethnique et Industrielle, Michael DeWitt cherche la musicalité pour étayer son propos et parvient à composer des mélodies certes monotonales (parfois assez proche des bourdons indiens), mais pleines de sens et titillant les nôtres.
« Town Of Pyramids (Night Of Pan) » ne dure qu’une poignée de minutes, fait rare pour ce genre de musique, mais laisse un sentiment de malaise profond, comme un rêve étrange se transformant en cauchemar sans que l’esprit n’arrive à en décoder le sens. Les vibrations, les diverses couches se superposant et cette fin abrupte contribuent à créer une atmosphère onirique, comme si les instruments maniés par le créateur appartenaient à un autre monde, moins tangible, et plus basé sur l’imaginaire ou la traduction de doctrines anciennes.
On accepte alors de se perdre tout au long de ces trois minutes et quelques secondes, quittant le rivage de la lucidité et de la normalité pour se perdre dans un monde parallèle ou le vocable musical prend un tout autre sens.
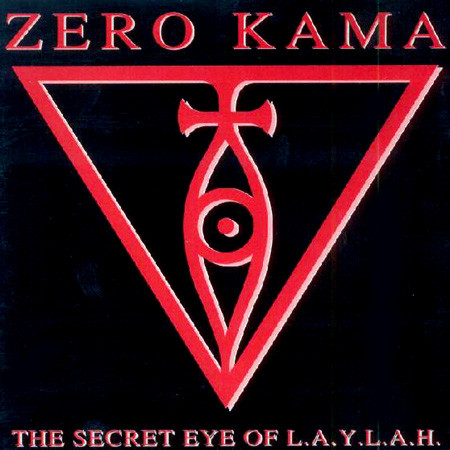
Mais je vous parlais de plusieurs raisons expliquant l’unicité de cet album, et la seconde est assez limpide. Tous les instruments utilisés sur cet album ont été fabriqués à partir d’ossements humains et de crânes. Une fois cette information en votre possession, réécoutez ce morceau, et demandez-vous comment Michael DeWitt est parvenu à tirer de ses créations ces sons éthérés et planants, qui pourraient émaner d’un synthé joué par un groupe Progressif des années 70.
Ces instruments ont été fabriqués uniquement pour cet album, et n’ont jamais été réutilisés depuis, ce qui rend The Secret Eye Of L.A.Y.L.A.H. encore plus fascinant. Depuis, Michael est devenu Zoe, et n’a jamais souhaité donner une suite à cet exercice Ô combien créatif et morbide. Ce qui est une bonne chose, puisqu’une séquelle n’aurait rien apporté, et aurait même sali la réputation étrange de ZERO KAMA, groupe d’un seul album, mais quel album…
23 - NEKROPHILIA - « Inter Feces Et Urinas » (Gallery Anal Hole, 1990)
Si certains morceaux utilisés pour ce dossier vous sont sans doute connus, je suis certain que cette entrée ne stimulera la mémoire de quiconque lisant ces lignes. Et pour cause, puisque cet album sorti en 1990 n’a été édité qu’en cassette, à vingt exemplaires, et jamais réédité depuis. Il est certes disponible sur la toile, mais au prix de recherches assez poussées. Je suis moi-même tombé dessus tout à fait par hasard, en scrollant les topics d’un blog consacré au minimalisme, à l’Ambient et à toute la famille Noise/Industriel/Harsh/Power Electronics, sans vraiment savoir ce que j’allais découvrir.
J’ai très vitre compris à quel sauce j’allais être mangé.
Peu d’informations circulent à propos de cet album et de ce groupe. Si de prime abord, on peut penser à un énième représentant Brutal Death désireux de se faire remarquer par un patronyme fleuri et des titres gentiment provocants, la réalité est tout autre. En effet, NEKROPHILIA évolue dans un registre de Dark Ambient, vraiment Dark, et salement oppressant.
Sorti sur le célèbre micro-label italien Semiotexterie (PLUME E SANGRE, SUBLIMINALE), Gallery Anal Hole est un exercice en deux parties, la première étant la plus désagréable des deux. Projet monté par les membres de VIVISECT, DEVILS WOMB et SAPROPHITA, NEKROPHILIA se situe dans une démarche résolument eighties, avec une assise rétro qui apporte aux sons ce cachet si analogique que les fans de Dark admirent tant.
Mais alors, de quoi parle ce morceau ? De rien. Il n’est qu’une longue litanie de vingt-trois minutes, décomposée en plusieurs parties, qui nous emmène d’un Dark Indus à un Dark Ambient en passant par la case field recording pendant quelques instants vraiment troublants.
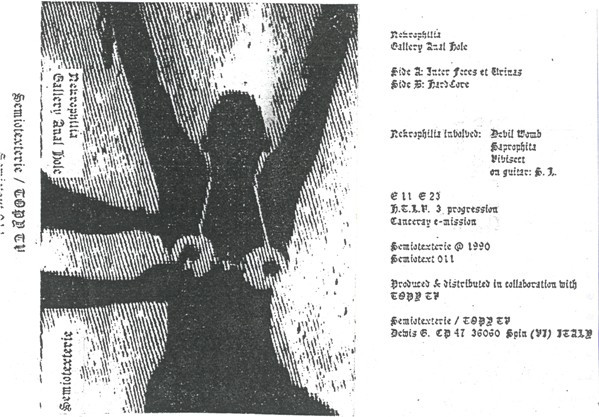
La première partie du titre est exactement ce que l’on attend d’un tel enregistrement. Des textures sonores empilées, des voix en arrière-plan étouffées, un climat de fournaise pour un tableau apocalyptique annonçant la sinistrose des nineties. Rien de vraiment choquant au demeurant, jusqu'à ce que la seconde parie n’intervienne, amenée avec beaucoup d’intelligence en fade-in.
A partir de la neuvième minute, des pleurs d’enfants se distinguent dans le fond sonore, opposant une émotion concrète à un instrumental torturé et noirci. Encore une fois, rien d’inhabituel à ça, la vague Dark Indus ayant souvent recours à des samples choquants, mais cette transition assez éprouvante s’étale dans le temps, sur plus de six minutes, pour en arriver à la nudité extrême de la bande-son, cédant la place à ces pleurs. Et écouter un enfant pleurer alors que le titre du morceau est « Inter Feces Et Urinas » peut poser un problème moral.

A moins d’y voir une métaphore sur la naissance, résumée à de l’urine et des déjections. De la mère évidemment, mais aussi du nouveau-né, et ainsi, poser trivialement un concept réduisant la poétique de la mise au monde à une simple accumulation de liquides et matières expulsées.
Biologiquement parlant, « Inter Feces Et Urinas » touche une corde sensible, et oppose une fin de non-recevoir à la mystique de l’accouchement, ici décrit dans tout son réalisme en gommant ses aspects les plus sublimes. Et plus simplement, l’irruption de ces pleurs d’enfant dans un contexte aussi Industriel et Noisy peut choquer, puisque les intentions des auteurs restent inconnues.
Vingt-trois minutes de bruit, de malaise, pour un album connu d’une toute petite minorité, qui en a précédé deux autres, dans la même veine. Un genre de secret bien gardé, et qui risque de l’être encore pendant des décennies.
Niveau -4 - Le labyrinthe de béton
24 - CHARLES MANSON - « Cease to Exist » (LIE: The Love And Terror Cult, 1970)
Je ne reviendrai pas ici sur l’histoire du non-tueur en série le plus célèbre des Etats-Unis, tout le monde la connaît, et tout le monde sait de quelle façon elle s’est terminée. Certes, la résumer pourrait replacer le contexte, mais si vous désirez en savoir plus sur ce petit prophète hirsute ayant profité de l’ère hippie de Californie pour regrouper autour de lui une faune de losers et autres runaways, plongez-vous dans les ouvrages disponibles qui sont légion.
LIE: The Love And Terror Cult est un album sorti en 1970, après les tristement célèbres meurtres de Cielo Drive qui ont conduit MANSON en prison, une fois de plus. On doit ce disque à l’opiniâtreté de Phil Kaufman, qui avait connu MANSON en prison, et qui fut brièvement membre de la Family. Kaufman avait d’abord insisté pour que MANSON enregistre ses titres avec les BEACH BOYS en backing Band, mais les bandes constituant l’essentiel de cet album furent enregistrées aux Gold Star Studios le 8 août 1968.
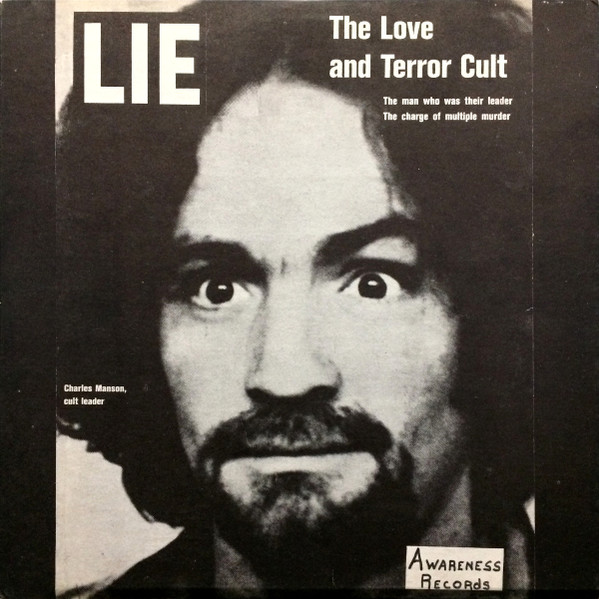
Avec MANSON derrière les barreaux, Kaufman tente de capitaliser sur l’attention nationale portée à son poulain, et sort LIE: The Love And Terror Cult à deux-milles exemplaires sur le label Awareness Records. L’opération coûta trois-mille dollars, mais l’album fut un flop, ne dépassant pas les trois-cents exemplaires vendus, alors qu’il était livré dans sa première édition avec un poster dédicacé par nombre de prisonniers en accord avec la philosophie de Charles MANSON.
Alors, pourquoi avoir choisi « Cease to Exist » plutôt que « Look at Your Game, Girl » ? Tout simplement parce que cette chanson résume à elle seule les évènements ayant pris place entre 1966 et 1969, et la relation trouble entre la MANSON family et Dennis Wilson. Ayant lié amitié dans la seconde moitié des années 60, les deux hommes se respectent, et MANSON n’hésite pas à abuser de l’hospitalité de son célèbre ami, invitant toute personne désireuse de manger et boire gratuitement, sans oublier de prendre ces drogues qu’on trouve en masse chez le batteur des BEACH BOYS. Dennis a toujours été l’hédoniste du groupe, le seul à vraiment surfer, et la figure christique de MANSON le fascine, d’autant qu’il peut profiter des charmes de certaines de ses fidèles entièrement dévouées à la cause.
Le but de MANSON à la fin des années 60, est de devenir une Pop-Star. Il réalise qu’il est enfin en phase avec son époque, et un coup de main d’un des musiciens les plus célèbres du monde ne sera pas de trop. Il enregistre des démos qu’il fait écouter à Dennis, mais l’affaire fait long feu. Et un jour, en découvrant une chanson des garçons de la plage, MANSON rugit de colère en s’apercevant qu’il s’agit d’une de ses compositions, débaptisée et réarrangée pour coller au style des BOYS.
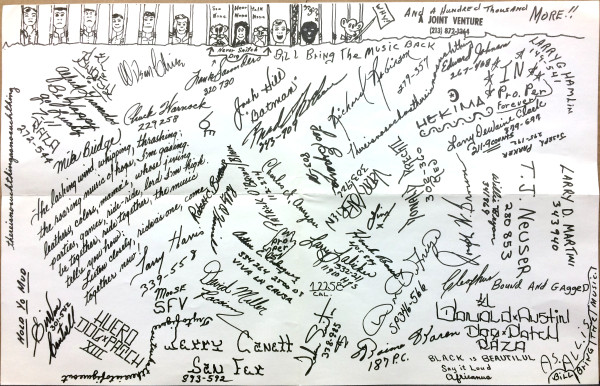
Ainsi, « Cease to Exist » devient « Never Learn Not to Love » (l’un des vers de la chanson), provoquant la rage de MANSON qui ne supportait pas qu’on modifie les paroles de ses chansons. Cet épisode marquera la rupture entre Charles et Dennis (et plus encore puisque l’intention avouée de MANSON était de purement et simplement éliminer Wilson), et annonce sans le savoir les débordements meurtriers à venir. Si l’on sait depuis longtemps que les meurtres de Cielo Drive n’avaient rien de rituel et découlaient juste d’un règlement de compte entre dealers fomenté par MANSON, la chanson a gardé son caractère prophétique, histoire d’amour, d’amitié et de partage déçus par la réalité de la vie.
Submission is a gift
Go on give it to your brother
Love and understandin'
Is for one another
Le titre n’a rien perdu de sa force brute aujourd’hui. L’approche de MANSON est caractéristique de ses jeunes années, proche d’un Blues traditionnel, très épuré, et réduit à sa substance la plus essentielle. La version présentée ici est forte, le chant de MANSON incroyablement bien posé, et « Cease to Exist » rappelle ces Folk traditionals des années 30, chantés avec fougue, et le plus souvent accompagnés au piano ou à la guitare.
C’est certainement l’un des titres les plus abordables de cette longue liste. Toutefois, avec en mémoire un contexte très particulier et l’un des procès les plus médiatisés du vingtième siècle, « Cease to Exist » ne manque pas de ramener à la mémoire les meurtres sanglants du 10050 Cielo Drive, qui auront coûté la vie à cinq personnes : l'actrice de cinéma et mannequin Sharon Tate, enceinte de huit mois et demi, épouse du réalisateur Roman Polanski ; son ami et ancien amant, le coiffeur renommé Jay Sebring ; Wojciech Frykowski, ami, ancien producteur, scénariste et garde du corps de Polanski ; et Abigail Folger, amante de Frykowski, héritière de la fortune du café Folgers et fille de Peter Folger et Steven Parent, un étudiant de dix-huit ans.
L’aura de ce morceau est donc particulière, et laisse un arrière-goût malsain dans la bouche, considérant le fait que si MANSON avait eu la chance de jouer ses chansons pour le plus grand nombre, cette tragédie n’aurait certainement pas eu lieu.
Si une version alternative de l’histoire de la Family vous intéresse, je vous conseille la lecture du très complet Le Dossier Manson écrit par Nikolas Schreck, ouvrage qui met à mal la théorie du procureur Vincent Bugliosi, en dévoilant des pans méconnus de l’histoire de ce petit bonhomme qui fut jusqu’à sa mort, l’ennemi public numéro 1 de l’Amérique des sixties.
25 - PETER ALSOP - « Where Will I Go ? » (Stayin' Over, 1982)
Voici sans doute le meilleur exemple de décalage entre musique et paroles de ce dossier. Et pourtant, dire que le nom de Peter ALSOP n’est pas vraiment connu est un euphémisme. Je ne me souviens plus de la façon dont je suis tombé sur ce titre improbable tout au long de mes pérégrinations sur YouTube, toujours est-il que lorsque je l’ai découvert, ma mâchoire est restée bloquée pendant deux minutes et vingt secondes.
Peter ALSOP est né dans le Connecticut et a été élevé dans une famille rongée par l’alcoolisme. Ce qui ne l’a pas empêché d’obtenir plusieurs diplômes prestigieux et de devenir un professeur respecté et admiré. Mais l’enseignement n’a pas été sa seule occupation, puisqu’il s’est aussi consacré à la rédaction d’ouvrages, la réalisation de courts-métrages, mais aussi à la composition de musique. Sa carrière a duré une grosse dizaine d’années, et s’est scindée en deux parties, la première étant consacrée au Folk réservé à un public adulte, et la seconde, celle qui nous concerne, aux chansons pour enfants. En gros, une sorte de Corbier à l’envers.
Sauf qu’il y a chansons pour enfants et chansons pour enfants. Sur son album Stayin' Over de 1982, on trouve évidemment des airs enfantins bien innocents comme « Nous les enfants, nous nous lavons les dents », « Si tu aimes un hippopotame », « Cher Mr Président », mais aussi des choses plus étranges, et certainement liées à son enfance, comme « Pas d’excuse pour picoler!», « Aaargh! » ou encore cet improbable « Where Will I Go ? ».
Ecouter ce morceau sans tenir compte du contexte et des paroles n’a rien de bien captivant. Mais les anglophones trouveront rapidement où se situe le malaise, et encore plus lorsqu’ils verront le clip illustrant la chanson. En gros, Peter chante avec plusieurs enfants, qui entonnent des vers tous plus morbides les uns que les autres. D’où cette thématique « Où irais-je quand je serai mort ? », pas tout à fait appropriée pour des bambins en jeune âge.
De là, le panel est représentatif. Les enfants commencent par citer les divers endroits recueillant les animaux morts, des toilettes pour les poissons rouges au vétérinaire pour les chiens, en passant par grand-mère « rentrée à la maison dans un pot rempli de cendres ». Le tout sur un air guilleret de chanson de cantine, qui met évidemment mal à l’aise.
La vidéo est totalement irrésistible, et serait certainement impossible à tourner de nos jours. D’autant que le chanteur passe en mode Psycho, proposant aux enfants de conserver son corps après la mort, de l’habiller et de l’installer dans une chaise de cuisine. On a vu proposition plus appropriée à des enfants entre 5 et 12 ans, mais Peter ne perd jamais son air affable et son humour plus que tongue-in-cheek.
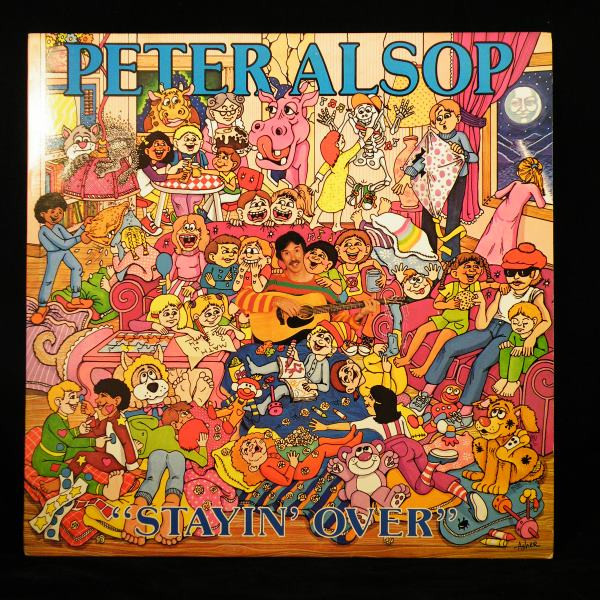
S’il est évident que le sujet de la mort a toujours été sensible au regard d’un public d’enfants, je ne suis pas certain que ce petit refrain soit la meilleure solution pour les informer du caractère définitif du trépas. Même si effectivement, les sensibiliser au don d’organes, à la perte de leur animal de compagnie n’est pas sans fondement, les laisser chanter de telles paroles a de quoi traumatiser bien des parents.
« Ces choses ne sont pas pour les enfants » chante une petite blonde qui s’étonne de mettre tout le monde mal à l’aise avec ses questions.
Une fois que vous aurez regardé cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. Amusante mais profondément dérangeante, elle offre un regard sur une autre époque où les sujets n’étaient pas encore tabous.
26 - LIL’ MARKIE - « Diary Of An Unborn Child » (Volume 1, Unknown date)
Nous commençons à atteindre les profondeurs abyssales du malaise et de l’inconfort, et cette entrée va nous enfoncer un peu plus dans la fosse commune du bon goût et de l’objectivité thématique. LIL’ MARKIE ne pouvait évidemment être qu’américain, terre de contradictions entre débauche pure et dure et puritanisme terroriste, dont les villes sont parsemées de chapelle, d’église et autres lieux de culte, et dont les chaînes de télévision réservent un créneau appréciable aux prédicateurs et autres représentants divins qui ont la sale habitude de vous demander de mettre la main au porte-monnaie. Mais le cas de LIL’ MARKIE appartient à une dimension particulière de la bondieuserie américaine, si formidablement bien brossée par la série The Righteous Gemstones.
LIL’ MARKIE s’inscrit dans la plus droite lignée de ces personnages imaginaires développés pour renforcer un message pieux, souvent douteux, et toujours intéressé. Mais il semblerait que le cas de ce petit personnage fictif échappe à la règle, tout comme son concepteur/géniteur. Ce petit bonhomme est la création d’un certain Mark FOX, chrétien engagé et passionné, qui pendant des années a parcouru les routes et arpenté les podiums pour propager la bonne parole. Evidemment, Mark n‘a rien d’un précurseur, et embrasse la destinée de ces chevaliers entièrement dévoués à la cause d’une religion qu’ils estiment seule possibilité d’être sauvé du marasme de l’indécence, mais il y a un détail qui le sépare de tous les autres V.R.P en bibles et crucifix de son espèce : sa voix.
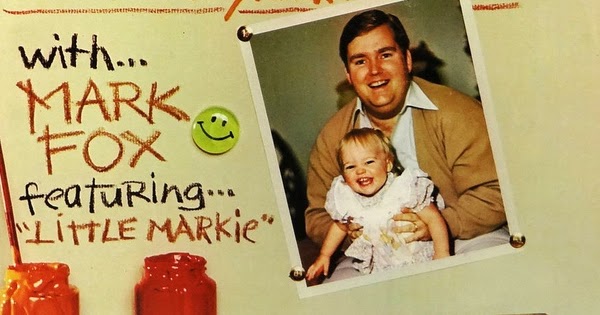
Alors que la majorité des artistes chrétiens utilisent la technique de la ventriloquie pour donner voix à leur personnage fictionnel, Mark se contente d’utiliser sa propre voix, incroyable, et qui une fois devenue celle de LIL’ MARKIE ressemble à un perroquet enrhumé sous hélium, contrastant de fait cruellement avec son physique corpulent et sa bonhommie souriante. Une vidéo tourne depuis des années sur YouTube, prouvant que Mark n’a jamais eu recours à des effets ou artifices pour produire ces sons. Ce qui le rend encore plus terrifiant.
Le répertoire de Mark sous l’alias de LIL’ MARKIE n’est pas très conséquent, mais chacune des chansons interprétées vaut son pesant de terreur. Entre les biens nommés « L’histoire d’un père alcoolique » et « Jésus est entré dans mon cœur aujourd’hui », on trouve des horreurs enfantines comme « Jésus a placé les étoiles dans le ciel » qui nous énumère tous les animaux et insectes de la création ou encore le plus dramatique « Journal intime d’un enfant non né ».
« Diary Of An Unborn Child » n’a pas été créé par Mark, mais par un journaliste anonyme qui l’a écrit en 1970 selon les sources. Ce texte fermement anti-avortement a longtemps été le leitmotiv des associations militant pour interdire l’avortement dans certains états des USA, avant de devenir l’un des chevaux de bataille de Mark FOX, qui l’a adapté en chanson pour le plus grand déplaisir de notre conscience et de notre santé mentale.

« Diary Of An Unborn Child » est vraiment agencé comme un journal intime tenu par un fœtus dans le ventre de sa mère. Entre la prise de conscience de son être jusqu’à la découverte de la vision, toutes les étapes de la grossesse sont décrites, renvoyant la plupart du temps assez habilement à l’amour que porte un enfant non né à sa mère. Musicalement, le titre est relativement pauvre. La mélodie est circulaire et répétitive, et ne sert qu’à mettre en valeur des mots qui font froid dans le dos. J’en reproduis ici quelques extraits pour situer le malaise palpable :
NOVEMBER 12: Tiny fingers are beginning to form on my hands. Funny how small they are! I’ll be able to stroke my mother’s hair with them.
NOVEMBER 20: It wasn’t until today that the doctor told mom that I am living here under her heart. Oh, how happy she must be! Are you happy, mom?
NOVEMBER 25: My mom and dad are probably thinking about a name for me. But they don’t even know that I am a little girl. I want to be called Kathy. I am getting so big already.
Comme vous le constatez, tout ceci est pris à un terrible premier degré, et restitué comme une sorte de chantage exercé pour faire plier une mère désirant avorter. Mais le fait que Mark parle ces couplets avec cette voix si étrange et comme sortie d’un cauchemar donne encore plus de poids à ces mots, destinés à culpabiliser les mères immorales et les défenseurs du droit à l’avortement. Et alors que la mélodie cède soudain la place à une note grave et dissonante, Mark lâche ce dernier vers parlé :
DECEMBER 28:
Today my mother killed me.
La suite et fin de la chanson voit le narrateur redevenir chanteur, et entonner de sa voix de volatile déplumé un « Maman, pourquoi m’as-tu tué ? » se voulant larmoyant, mais ne soulignant en fait que le caractère trouble d’un pamphlet maladroit. La version de LIL’ MARKIE, contrairement au texte initial desservira les anti-avortement aux Etats-Unis, ce morceau préférant une sorte d‘humour noir involontaire à la sècheresse argumentaire de départ. Mais il est très difficile d’écouter cette chanson improbable sans penser au climat puritain dans lequel baignent de nombreux états américains, encore à notre époque. Après tout, depuis que la Cour Suprême a révoqué l’arrêt Roe v. Wade, protégeant le droit à l'avortement dans tout le pays, un état comme le Texas s’est empressé de prendre des sanctions contre quiconque pratique un avortement.
« Diary Of An Unborn Child » est en quelque sorte l’hymne de ce retour au puritanisme. Et même si Mark FOX nous a quittés en 2016 à l’âge de 61 ans, son héritage demeure, et il reste l’un des artistes chrétiens les plus étranges et dérangeants de sa génération.
27 - Jeanne Folly, J.L Hennig, VXZ 375, Hektor Zazou, Bazooka - « La Soupeuse » (La Perversita, 1979)
Sorti en 1979 et réalisé à partir d’ateliers en établissements psy, l’album pour estomacs bien accrochés, fruit des esprits provocateurs du musicien Hector Zazou, de l’autrice Jeanne Folly, de VXZ 375 alias Bayon et de Jean-Luc Hennig (ex-«Libé») est réédité. (Libération)
Collectif d’artistes de tous horizons, La Perversita reste l’un des albums les plus provocants et pervers - comme son nom l’indique - du paysage musical français de la fin des années 70. Consacré aux perversions les plus ultimes, il constitue aujourd’hui un témoignage fidèle de la libération des mœurs des années 70, et se concentre sur des histoires psychiatriques collectées de çà et là. Ici, tout est fait pour choquer les bonnes âmes, sans aucun recul ni second degré. Le but étant de faire allusion à des pratiques que la morale réprouve durement, les artistes impliqués n’ont pas hésité à pousser le bouchon le plus loin possible en nous ouvrant un catalogue de dégueulasseries et d’ignominies à faire vomir un psychopathe endurci.
La pochette abstraite et absconse (en réalité, une déviation graphique sur un médecin auscultant un urètre au stéthoscope) ne révèle pas grand-chose des intentions des auteurs. Mais en s’emparant de la pochette intérieure et du vinyle en lui-même, la clarté du propos apparaît. Sexes féminins béants, assemblée lubrique, visages étranges, jusqu’à cette petite fille nue les jambes écartées sur la vignette du 33 tours. On sait immédiatement que l’épreuve va être difficile, et que l’écoute de ce disque laissera des traces profondes dans la mémoire.

On trouve sur la pochette interne tous les renseignements utiles à la compréhension de ce disque. A l’origine, des ateliers de musicothérapie donnés par Jacques Pasquier, à la clinique de La Borde ou à l’hôpital du Chesnay, explorant diverses pistes divergeant de celles proposées par la psychiatrie institutionnelle. Pasquier l’avouera lui-même, il lui était impossible de savoir s’il était intervenant ou patient durant ces sessions, mais il en ressortira la musette pleine de témoignages sur la sexualité déviante de certains de ces patients institutionnalisés. Des témoignages précieux qui ont abouti à l’écriture de cet album légendaire.
Tout y passe, nécrophilie, zoophilie, cannibalisme sexuel, recensement des déviances les plus vicieuses de la faune psychiatrique de l’époque, qui aurait tout aussi bien pu être l’illustration des vices non cachés d’une décennie qui en termes psychiatriques avait prôné l’ouverture à la sexualité des enfants au même titre que les bienfaits d’une partouze entre gens de la bonne société.
Mais le propos ici n’est pas d‘exciter gratuitement quelques voyeurs auditifs en manque de sensations fortes. Il est résolument de choquer avec des propos crus, relatant des expériences vécues avec des patients d’hôpitaux prisonniers de leurs vices. Et dans ce dédale de lubricité se cache le plus bel hymne jamais registré en l’honneur des zombies des vespasiennes parisiennes, « La Soupeuse ».

Pour précision, sachez que le terme « soupeuse » désigne une personne qui dès le matin, dispose des morceaux de pain dans les urinoirs des vespasiennes parisiennes, pour les récupérer le soir et s’en délecter. Evidemment, une partie de la journée sera dédiée à l’observation des quidams utilisant les latrines pour se soulager, histoire de garder en mémoire les visages, les silhouettes, et éventuellement, les sexes.
« La Soupeuse » est sans aucun doute l’acmé d’un album terrifiant, qui à l’époque ne fit pas grand bruit. En dix minutes, un instrumental robotique et redondant sert d’assise à la voix détachée et désabusée de Jeanne Folly, journaliste à Libération, qui déclame un poème déviant d’un ton monotone au possible, qui contraste cruellement avec l’acidité ammoniaquée du texte. Le but de cet album était de mettre en lumière un certain minimalisme musical (surnommé à juste titre boring music), tout en traitant de sujets susceptibles de choquer les âmes les plus souillées.
Et le but a été atteint, de plein fouet. Si certains titres, mélangeant électronique, Rock, avant-garde et dadaïsme ont mal vieilli, « La Soupeuse » reste étonnamment actuelle, même si la perversion qu’elle décrit à disparu des toilettes parisiennes depuis longtemps. Mon père m’a souvent raconté que lors d’un de ses séjours à Paris durant son passé militaire, il avait assisté à l’une de ces scènes, découvrant totalement hagard un homme récupérant au fond des vespasiennes un morceau de pain trempé d’urine avant de le consommer avec délice. Je ne vous cache pas que cette ignoble image l’a hanté pendant des décennies…
« La Soupeuse », c’est la routine de la déviance. A ce titre, il est indispensable de souligner l’importance du chant de Jeanne Folly, qui d’une voie susurrée à la manière d’un automate de station-service déroule les vices de ce poème urinaire qui replace l’urophilie au centre des débats. Si les paroles sont difficiles à comprendre du fait de leur noyade dans la bande instrumentale, certains mots se détachent et brossent une scène hallucinante, et avouons-le, écœurante.
Et quand enfin, huit heures du soir sonnent, je me glisse, parmi les ombres, jusqu’au cœur de mon royaume : la tasse. Je m’introduis, telle la voleuse en catimini, dans l’exquis palais-dégueulasse, temple de mes douceurs perverses, pour y repêcher mes merveilles « dégoutantes ». Oh mes petites éponges ! A moi ! Mes miracles mouillés ! Les effluves d’urines mêlées me tournent la tête…
Rarement déviance sexuelle aura trouvé tribune plus fidèle et respectueuse. Downbeat, basse à l’économie, absence totale de mélodie, « La Soupeuse » reste l’un des témoignages les plus saisissants des seventies parisiennes libérées et affranchies, et une ode incroyable aux fantômes des pissotières qui se délectaient de ces petits croutons de pain imbibés d’urine(s).
Tous les goûts sont dans la nature. Et tous les dégoûts dans la ville.
Niveau -5 - Les catacombes
28 - LINGUA IGNOTA - « Woe To All (On the Day of My Wrath) » (All Bitches Die, 2017)
Celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. Et si tu regardes longtemps un abîme, l’abîme regarde aussi en toi.
Cet aphorisme de Nietzsche est dans doute l’un des plus utilisés au monde, et décrit avec une certaine acuité le processus d’admission d’une part d’ombre chez tous ceux luttant contre les ennemis de l’ombre. Néanmoins, il arrive parfois que quelqu’un ou quelque chose vous oblige à regarder l’abîme, à tel point que vous n’être plus capable de voir la lumière autour de vous, ou de revendiquer ce statut de victime que les agresseurs nient pour terroriser leurs proies. C’est peu ou prou ce qui est arrivé à Kristin Michelle Hayter, abusée physiquement et mentalement pendant des années.

Kristin est une musicienne, auteure et compositrice américaine, né en Californie en 1986. Sa jeunesse se passe de groupes de Metal entre amis à une musique plus personnelle, avant que l’artiste n’adopte définitivement le nom de LINGUA IGNOTA, la langue inconnue en latin.
LINGUA IGNOTA est donc la catharsis de Kristin, le vecteur d’expression qui lui permet d’exorciser sa douleur, accumulée pendant des années, et régurgitée sous la forme d’une musique indescriptible, aux confins de l’Avant-garde, du Noise, du Dark Ambient et du Néo-classique. Ses deux premiers albums, les plus fondamentaux et abrupts ont été publiés à compte d’auteur, avant que la chanteuse ne rejoigne l’écurie Profound Lore. Mais sans aucun doute possible, All Bitches Die est de loin son cri primal le plus violent et traumatisant.
My master pulled me from my bed
Ripped every curl from out my head
Held me down to strip me bare
Said « Hell is real, I'll take you there »
En quinze longues minutes, Kristin dépeint un univers de violence, de revanche et de reprise d’ascendant, en trois tableaux de durées inégales. Les cinq premières minutes du morceau ressemblent assez à ce que Margaret Chardiet peut produire via PHARMAKON, soit un tapis sonore bruitiste déchiré par des hurlements à glacer le sang. Et puis, Kristin change d’ambiance, passe au duo piano/voix, et chante cette fois-ci comme une diva perdue dans les limbes de son propre cauchemar, mais qui élabore un plan pour reconquérir sa dignité. La fin du morceau reprend le thème initial pour apporter une conclusion bruitiste et dissonante.
A l’écoute de ce morceau et de cet album, on comprend toute l’influence qu’ont pu avoir des artistes comme Patty WATERS et Diamanda GALAS sur Kristin. Même liberté dans l’utilisation de la voix en tant qu’instrument à part entière, thèmes en Némésis d’une société pourrie jusqu’à la moelle, et rapport de force inversé avec les hommes, qui obtiennent beaucoup trop souvent gain de cause au regard de la justice. Kristin est malheureusement passée par cette étape cruelle, moquée par les autorités, et mise au ban par son établissement, le temps d’une procédure qui tenait plus volontiers du chemin de croix.
Nul besoin d’être une femme pour apprécier ce morceau et son texte à leur juste valeur. « Woe To All (On the Day of My Wrath) » est une ouverture extraordinaire qui place immédiatement All Bitches Die sous des auspices sombres, et qui malmène l’auditeur pour lui faire réaliser que le voyage musical sera tout sauf un long fleuve tranquille.

De nombreux morceaux de LINGUA IGNOTA auraient pu atterrir sur cette liste. Depuis Let The Evil Of His Own Lips Cover Him, l’artiste a produit des œuvres essentielles, entre Caligula et Sinner Get Ready, et son approche ultra Noisy et quasi Industrielle a subi des mutations pour devenir plus abordable, sans en trahir le propos.
Pour être plus factuel, le musicien décrit par Kristin comme étant son bourreau n’est autre que le leader de DAUGHTERS, Alexis Marshall. C’est pour cette raison qu’aucun titre de DAUGHTERS n’apparaît dans cette liste, carséparer l’homme de l’artiste était impossible. Après tout, sous ses coups, Kristin a souffert le martyre, et a dû subir des opérations à la colonne vertébrale, et le dilettantisme des structures a fait dire à Kristin que le système est d’une inefficacité inouïe pour les victimes de violence sexuelle et domestique.
Celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même
Espérons que Kristin ait terminé de combattre ses monstres pour ne plus avoir à regarder dans l’abîme.
29 - THE BOYD RICE EXPERIENCE/JIM GOAD - « Let's Hear It For Violence Towards Women » (Hatesville!, 1995)
BOYD RICE est ce qu’on appelle une figure dans le milieu Noise/Industriel des années 70/80/90, au même titre que David TIBET, Douglas PIERCE ou Rose MCDOWALL. Dès 1976, l’artiste américain s’éloigne des méthodes de production de son pays, entièrement dévouées aux gémonies des EAGLES et autres bouffeurs de charts et d’ondes radio. Il fonde rapidement NON, toujours en activité de nos jours, puis se laisse aller à un nombre hallucinant de side-projects et de collaborations avec d’autres acteurs du milieu. Il nous introduira tout au long de sa carrière aux exactions de BOYD RICE & FRIENDS, THE BOYD RICE EXPERIENCE, BOYD RICE PRESENTS, qui lui ont permis de défricher encore plus de terrain, musicalement et conceptuellement.
RICE est l’exemple même de musicien, auteur, ou graphiste controversé. Ses implications, son goût pour la provocation, ses blagues de mauvais goût (notamment sa session photo avec un membre du White Nationalist American Front Bob Heick, ou ses nombreux passages dans l’émission Race and Reason présentée par le suprématiste blanc Tom Metzger) en ont fait une cible parfaite pour le mainstream artistique américain, quoi qu’il se soit toujours défendu d’accointances avec le milieu néo-nazi local. Mais nul besoin d’aller chercher dans sa bio les détails le mettant dans l’embarras, sa musique parle la plupart du temps pour elle-même.

Ainsi, vingt ans après son émergence sur la scène, BOYD lâche un album étiqueté THE BOYD RICE EXPERIENCE, concept qu’il partage avec Adam PARFREY, Shaun PARTRIDGE, et Jim GOAD. Cet album baptisé Hatesville! et composé de quinze morceaux offre une lecture assez intéressante de l’Amérique de l’époque, et certains titres, éloignés d’une quelconque forme de musicalité ont largement leur place dans ce dossier, mais certainement pas autant que l’infâme « Let's Hear It For Violence Towards Women » signé par Jim GOAD.
Le premier vers de ce titre place la barre très haute :
Les femmes sont tout juste bonnes à se faire baiser et cogner.
De ce point de départ découlera un morceau long de plus de six minutes, entre Industriel minimaliste, spoken words, Noise et pamphlet provocateur. Le texte de ce morceau est très long lui aussi, et très graphique dans ses images. Si l’on comprend bien que ce morceau a été écrit du point de vue fictif d’un homme misogyne et violent, et non par un adepte réel des violences domestiques, il n’en met pas moins terriblement mal à l’aise. Outre ce beat à la TAMBOURS DU BRONX claqué comme une horloge bien huilée, cette voix traitée qui récite son texte avec conviction, ce sont surtout les cris de femme récurrents, mêlés à des gémissements de plaisir, qui donnent du sens à ce premier vers si prophétique :
Les femmes sont tout juste bonnes à se faire baiser et cogner.
Pendant plus de six minutes et trente secondes, la voix égrène les sévices, les tortures, et le résultat constaté qui emplit de plaisir un sadique qui n’envisage les femmes que comme exutoire, et sexe faible tout juste bon à se soumettre à l’autorité masculine.
Women are defined by those cunts and nothing else
Women want their lovers to be kickers, give them what they want.
She struggles. He pulls a knife from his boot and slices a deep red notch running from her throat down to her pussy.
She falls to the forest floor, splashing blood onto the autumn leaves.
He covers her mouth and fucks her ass.
He blows his jam up her fudge hole as she dies.
She asked for it.
Quelques exemples parmi tant d’autres de ce texte incroyablement cru, qui pose la question de l’invalidité d’une société patriarcale et l’inactivité des pouvoirs publics inondés chaque nuit d’appels au secours, de noms de victimes, d’adresses et de cris de douleur et de frayeur. Beaucoup d’artistes ont chanté ce thème au travers des années, mais rarement morceau aura abordé le sujet d’une façon aussi froide et mécanique qu’un tueur en série analysant ses crimes pour entretenir sa propre légende.

Les néophytes assez éloignés de l’univers de BOYD RICE risquent de prendre le tout au pied de la lettre, et d’y voir un manifeste intolérable sur la suprématie masculine dans la société, et les excès qui en découlent. Il faut dire que loin des métaphores, des images et autres formules rhétoriques, « Let's Hear It For Violence Towards Women » est cru comme un bleu sur le visage d’une femme éclairé par une lampe de chevet, ou comme une déposition inutile au commissariat de police, jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
La chanson, longue et répétitive accentue cette sensation de malaise et d’oppression, et se termine par une question en forme de pied de nez pourtant très réaliste.
Vous ne croiriez pas une femme quand même ?
Beaucoup répondraient à cette question par la négative. Encore aujourd’hui, et sans aucun doute demain.
30 - DEATHPILE - « You Will Never Know » (G.R, 2003)
Power Electronics vs Harsh Noise.
Débat plus ou moins intéressant pour savoir lequel des deux genres est le plus cacophonique, bruyant et dérangeant. Mais au-delà de cette volonté d’utiliser les sons les plus répétitifs et abrasifs, ce sont surtout les thèmes abordés par ces deux styles qui interrogent. La plupart du temps, la tribune est réservée aux pires (sé)vices de l’humanité, aux tragédies les plus graves, et aux déviances les moins excusables. Ce qui semble relativement normal au vu de la puissance sonore surhumaine développée et cette volonté de choquer et perturber. Après tout, on imagine assez mal CANNIBAL CORPSE nous parler de la tranquillité des dimanches à la campagne, ou Diamanda GALAS roucouler en regardant des enfants chercher des œufs de Pâques.
Mais à ce petit jeu de provocation, DEATHPILE sort grand vainqueur, et de loin.
DEATHPILE est un projet créé par Jonathan Canady, qui a impliqué selon les époques plusieurs partenaires, dont Brian D'Agosta, David E. Williams, ou Don Poe. Dès le départ et Random Acts Of Cruelty, premier album sorti sur cassette de façon plus que confidentielle, DEATHPILE se démarque des autres acteurs de la scène par la violence sans compromis de son instrumental, et de son chant hurlé, à la limite de l’apoplexie.
DEATHPILE est une figure du milieu, et contrairement à nombre de ses homologues, ne nous a pas assommés de trente albums par an sous divers formats. Même si sa discographie est riche pour une durée somme toute limitée (1995 à 2004, moins d’une décennie), elle reste assez modeste et concentrée, ce qui a permis à Jonathan Canady de ne produire que des œuvres essentielles, qui aujourd’hui encore servent de mètre-étalon pour les acteurs du cru. Spécialement la dernière, ce qui est assez rare dans le monde de la « musique ».

Je ne nie aucunement l’importance d’albums comme Triumph of Death ou Back on the Prowl, mais il est impossible de ne pas désigner G.R. comme le chef d’œuvre absolu de la production de DEATHPILE. Vingt ans après sa sortie, G.R. est toujours considéré comme l’épitomé d’un style pourtant exigeant, et pratiqué par un nombre conséquent de terroristes sonores. Alors pourquoi cette sortie de 2003 a laissé autant de traces dans le cœur des fans de bordel intense et d’horreur conceptuelle ? Tout simplement parce qu’il est réellement effrayant et terriblement bien construit.
G.R. raconte l’histoire de Gary Ridgway, d’où les initiales, connu sous le nom de « Tueur de la Green River », d’où…les initiales. Double allusion donc pour décrire le parcours d’un des tueurs en série les plus ignobles et prolifiques des années 1982 à 2001. On estime le nombre de ses victimes entre 49 et 90 femmes, chiffre plus qu’honorable pour un serial killer, mais c’est surtout son mode opératoire qui en a fait un ennemi terrible à combattre pour les forces de police. Gary amadouait parfois ses victimes en leur montrant une photo de son fils, avant de les violer, de les tuer, ou de les tuer, puis de les violer. En gros, le parcours classique d’un tueur froid, implacable, et sans aucune empathie.
DEATHPILE se propose donc d’aborder son cas de la seule façon possible : sans complaisance, crument, violemment, sur fond de Power Electronics assourdissant, entre saturation extrême et grondements à la LUSTMORD. Les neuf morceaux de cet album sont évidemment indissociables, et tous tétanisant, dans divers registres. Pour illustrer ce cas, j’aurai pu utiliser « Known Victims », sur lequel une voix atonale égrène les noms des victimes de Gary, mais c’est « You Will Never Know » qui illustre le mieux toute l’horreur de l’affaire.
Dernier album, dernier morceau. Jonathan Canady a voulu marquer les esprits avant de disparaître, et il n’est guère surprenant de retrouver cet épilogue dans diverses listes consacrées aux morceaux les plus perturbants. Si la trame artistique ressemble beaucoup à « Addicted», ce sont les paroles hurlées qui font de « You Will Never Know » un sommet d’ignominie et de réalisme.
Ce dernier titre se propose en effet d’entrer dans l’esprit du tueur, pour avoir un semblant d’explication à ses actes barbares. Evidemment, pas de happy end à attendre d’un concept comme DEATHPILE, mais autant dire que le bouchon a été poussé le plus loin possible pour instaurer un malaise durable chez l’auditeur.
Tout ce que j’ai vu, tout ce que j’ai fait est caché dans ma tête.
Dès les premiers vers, on comprend que le sentiment de culpabilité n’agitera pas la conscience de Gary Ridgway, bien au contraire. L’homme tient à garder ses secrets, et ne révèlera jamais dans quel état d’esprit il était lorsqu’il assassinait une pauvre innocente avant de jeter son corps dans la Green River.
Les ai-je baisées avant qu’elles ne comprennent qu’elles allaient mourir ?
Ou m’ont-elles imploré de les épargner alors qu’elles s’étouffaient sur ma queue ?
Etait-ce des larmes de désespoir mélangées à mon sperme sur leur visage ?
Les ai-je torturées ?
Les ai-je battues ?
Les ai-je violées plus d’une fois ?
Est-ce que j’ai joui en les étouffant ?
Ou est-ce que ma queue était à l’intérieur d’elles au moment de leur mort ?
Cette thérapie par l’aveu d’ignominie est terriblement difficile à écouter. A cause de la nature même de l’approche Power Electronics, mais aussi de par cette voix atroce et traitée qui hurle des atrocités avec un détachement inouï. Mais ce qui choque et traumatise vraiment est la conclusion de ce morceau/album, qui n’offre aucune échappatoire à l’horreur et ne prodigue aucune réponse quant aux questions posées.
Ai-je des remords ?
Est-ce que je me sens fier ?
Est-ce que je ressens quelque chose ?
Vous ne le saurez jamais
Et je ne vous le dirai jamais.
Difficile de faire plus atroce, en prenant en compte le fait que ces évènements ne sont pas de la fiction créée pour choquer, mais bien le parcours sanglant d’un déséquilibré qui a ôté la vie à des dizaines de femmes sans autre justification que son propre plaisir.

Il était impensable pour DEATHPILE de revenir avec un autre album, considérant la perfection de G.R. qui ne pouvait être ni dépassée, ni égalée. Ce testament sonore reste l’une des épreuves les plus éprouvantes de la scène Power Electronics, et constitue au même titre qu’un The Downward Spiral le chef d’œuvre absolu d’un genre pourtant souvent porté sur l’agression gratuite et l’envie de choquer à tout prix, quitte à verser dans le ridicule.
31 - NICOLE 12 - « Ballerina » (Substitute, 2004)
Que la controverse commence.
Mikko Aspa, né en Finlande, est le prototype même de l’hyperactif incapable de se concentrer sur un projet unique. Non seulement le bonhomme se disperse dans divers groupes comme ALCHEMY OF THE 20TH CENTURY, CLANDESTINE BLAZE, CLINIC OF TORTURE, CREAMFACE, DORCHESTER LIBRARY, FREAK ANIMAL RECORDS, GRUNT, INDUSTRIAL RECOLLECTIONS, MIKKO ASPA, NIHILIST COMMANDO, NORTHERN HERITAGE, SILENCE OF VACUUM ou STABAT MATER, mais il a en sus créé des labels (Northern Heritage Records, Lolita Slavinder Records, Nykto Tapes, Creative Felony Productions, Freak Animal Records, Totuuden Sarvi Levyt), et tient même une boutique de disques. Un tableau de chasse impressionnant qui a de quoi laisser admiratif.
Pour la petite histoire, qui finit par devenir la grande, Mikko Aspa est également le chanteur des obscurs et terriblement bruyants DEATHSPELL OMEGA, ce qui achève de compléter un tableau déjà bien chargé.

Alors, en quoi consiste son rôle dans ce dossier, qui finalement, le concerne au plus haut point quand on connaît son parcours ? Tout simplement parce le bonhomme a la sale habitude de traiter de sujets très sensibles avec la grâce d’un éléphant dansant le quadrille au Musée du cristal, et que certains de ses groupes, par extension, jouent avec la limite de la transgression morale…et la franchissent.
J’aurais pu aborder le cas de CLANDESTINE BLAZE, farouchement antisémite, mais c’est l’autre versant sombre d’Aspa qui est le plus troublant. Sa fascination pour la pornographie (il dirige un magazine pornographique ainsi qu’une série de vidéos baptisée Public Obscenities) l’a poussé à monter divers projets artistiques, dont l’infâme et impardonnable NICOLE 12.

Dans son Top 40 des morceaux les plus dérangeants, Feldup parle dans sa dernière rubrique d’un groupe qu’il se refuse à citer, et qui évolue dans un registre de Power Electronics. Son refus même de nommer le groupe vient de la thématique choisie pour illustrer les albums de NICOLE 12, qui n’est autre que la p*dophilie.
Il n’est guère besoin d’écouter la musique du projet pour comprendre quels en sont les tenants et aboutissants. Chaque pochette est flanquée d’une photo de jeune fille, de petite fille, dans des tenues évocatrices, et la pochette de Substitute serait même tirée d’une vidéo p*dopornographique, ce qui rend le malaise encore plus palpable.
Entendons-nous bien. Beaucoup d’artistes se sont exprimées à ce sujet dans leurs œuvres (la dernière polémique concernant le dessinateur Bastien Vivès et ses bande-dessinées plus qu’explicites prouve que le thème est toujours d’actualité), mais la plupart du temps, d’un ton provocant, légèrement gouailleur, et totalement en phase avec l’esprit Rock n’Roll qui exige une jeunesse éternelle. FAITH NO MORE en a tiré le jazzy « Edge Of The World », les KINKS « Art Lover », et même le grand Léo Ferré s’y est essayé avec « La Petite ». On ne peut donc pas dire que la thématique soit innovante, et on pensait d’ailleurs que plus rien ne pouvait la rendre plus effrayante mis à part les nombreuses affaires soulevées puis ignorées par la justice.
Mikko Aspa a certainement dû se dire qu’il pouvait faire pire que tout le monde. Certes, rivaliser avec le « Necropedophile » de CANNIBAL CORPSE semblera à certains impossible, pourtant, « Ballerina » de NICOLE 12, comme tout le reste de l’album et de la discographie nous entraîne dans les bas-fonds les plus répugnants de l’âme humaine.
On pouvait se douter que Mikko n’irait pas avec le dos de la cuillère pour décrire des fantasmes p*dophiles. Il a pourtant réussi à se surpasser, tout en gardant une trace de poésie dans son ignominie. Comme son titre l’indique, « Ballerina » multiplie les références aux justaucorps, aux positions équilibristes, et à la torsion du corps, objet de fétichisme pour de nombreux pervers fantasmant sur les petits rats de l’Opéra de Paris.
Toi et tes amies, vous étirant dans ces collants, dans des positions qui rendent vos orifices disponibles et pourtant cachés par le tissu
Rien ne le rendrait plus heureux que d’exhiber sa queue, plus grosse que ton bras, et pénétrer tous les orifices de son enfant bien-aimée.
Musicalement parlant, « Ballerina » n’a de lien avec le Power Electronics que le chant torturé et traité de Mikko, la bande instrumentale reproduisant la même mélodie au piano jusqu’à l’écœurement, entre deux arrangements stridents et oppressants. Le décalage peut sembler sordide, ce qu’il est assurément, mais ce sont les mots, hurlés, qui se détachent sur fond d’abus sexuels incestueux. Là où Gainsbourg jouait le trouble et l’équivoque, NICOLE 12 se pose en témoignage plausible de mois passés sur le Dark Web à lire des commentaires et des histoires infectes, afin d’en rapporter les propos.

En regardant tes mouvements, il voit des visions romantiques de toi t’étouffant sur son sperme, te tenant le ventre à deux mains, les yeux embués de larmes alors que tu regardes ces morceaux de collants déchirés.
Ce morceau, franchement pas terrible d’un point de vue musical, pose le problème de la transgression dans l’art. S’il est évident que le fantasme est préférable au vice, une telle précision dans la description d’agressions sexuelles sur des mineures ne manque pas d’interpeller. Peut-on excuser ces vers au nom d’une liberté de ton revendiquée dans le domaine artistique, ou faut-il accepter une frontière séparant le tolérable du punissable sans remettre en cause les fondements même de l’art ?
En écoutant les albums de NICOLE 12, je dois reconnaître que la transgression n’est pas justifiée par une démarche artistique viable. On sent que le propos de l’artiste n’a été que de choquer, provoquer, de façon tout à fait gratuite. Le cas échéant étant encore plus grave, si l’on considère que Mikko a fixé sur bande ses penchants sexuels plus que déviants. Alors Mikko, provocateur cheap et musicien médiocre, ou génie incompris osant aborder à sa façon des problématiques graves ?
J’ai mon opinion sur le sujet.
Niveau -6 - L’étage interdit
31 - ETHNIC CLEANSING - « Ethnic Cleansing » (Piles of Dead Jews 7’’, 1995)
Un festival de Black Metal à la gloire des nazis, prévu ce samedi 25 février aux alentours de Saint-Dié-des-Vosges, vient d’être interdit par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Que peut-on légalement reprocher à cet événement?
Comme nombre de ses homologues idéologiques, le festival Night for the Blood se heurte à une levée de boucliers de la part des pouvoirs publics et des élus locaux. L’affaire est même remontée jusqu’à l’Elysée, et seul un terrain privé pourrait éventuellement sauver les organisateurs d’une interdiction pure et simple. Une fois encore le NSBM fait parler de lui, et pas en bien. Et il attire les regards sur un style musical déjà controversé, persuadant ses détracteurs qu’il n’est qu’un refuge d’idéologies douteuses et d’accointances racistes.
Alors, faut-il oui ou non interdire une manifestation sous prétexte qu’elle véhicule un message de haine xénophobe, et exhale de sales relents de nazisme rance ? Si la question de la liberté d’expression dans l’art est d’une importance cruciale, il convient de mettre des barrières pour ne pas que les pensées les plus immondes n’entachent sa crédibilité et son sens de la provocation. Mais lorsque la provocation laisse place aux convictions, je pense sincèrement qu’il est temps d’intervenir et d’y mettre le holà.
On sait par expérience que tous les genres extrêmes attirent par essence des philosophies extrêmes. Le Black Metal évidemment, mais aussi le Dark Ambient, le Power Electronics, le Rituel, toutefois, nier que l’extrémisme contamine aussi des styles beaucoup plus mainstream serait d’une inconscience rare. Je connais des artistes Country néo-nazis, des groupes Pop, Rock, et de toute autre obédience musicale, puisque finalement, il n’est nul besoin d’aller vers les extrêmes pour y exprimer des idées qui le sont tout autant. Mais admettons quand même que les sous-genres agressifs sont les véhicules idéals pour hurler des logorrhées à base d’antisémitisme, d’homophobie, de racisme ordinaire et autre charge revancharde aussi construite qu’un mur de briques bâti par un épileptique. Et à ce petit jeu, malgré ses racines profondément antiracistes, le Hardcore a su se laisser séduire par la frange la plus rance de la tribune libre en Amérique profonde.

Ainsi, ETHNIC CLEANSING fonctionne comme une métonymie, ou une synecdoque selon le point de vue. Le groupe est utilisé ici comme emblème d’un mouvement global, et comme démonstration d’une théorie objective : le racisme n’a rien à faire dans la musique, censée rassembler les êtres et rapprocher les peuples.
Il existe des milliers d’albums, de singles, de cassettes véhiculant les idées néo-nazies si honnies dans nombre de pays. Une simple visite à l’infâme site NS88 vous suffira à comprendre que l’étendue du mouvement est bien plus vaste que ce que vous auriez pu imaginer. Des centaines de groupes, la plupart du temps autoproduits déversent leur bile sur les juifs, les noirs, les homosexuels, sans contrôle, et pour le plus grand plaisir de leur public. Certains vont très loin, mais je pense pouvoir dire que les américains d’ETHNIC CLEANSING font partie de ceux qui ont le plus rempli la louche.
Le nom même du groupe en dit déjà assez, mais on pourrait le prendre au second degré, et penser écouter la musique d’un groupe détruisant les arguments de purification dans une diatribe farouchement anti-xénophobe. Mais un simple coup d’œil à la pochette du 7’’ Piles of Dead Jews suffit à comprendre que le quatuor est bien un émule de la pensée hitlérienne, et que son message est limpide : les juifs sont la cause de tous les maux, et méritent d’être exécutés comme au bon vieux temps. Les noirs itou.
Je ne reproduirai pas ici la pochette de ce single, vous pouvez la voir sur le site référentiel Discogs si cela vous intéresse. Je ne posterai pas non plus de vidéo, d’une parce qu’il n’en existe pas, et d’autre part, parce qu’il est évidemment impossible pour moi de faire la promotion d’une telle assemblée de crétins consanguins qui ne tiendraient pas trois jours sous un régime fasciste.
Dès lors, qu’attendre d’un morceau comme « Ethnic Cleansing » d’un groupe du même nom ? Exactement ce que vous imaginez, une saloperie raciste si généraliste qu’elle en deviendrait drôle si le message n’était pas si écœurant. Mais jugez par vous-mêmes en lisant ces quelques vers si réfléchis et pertinents qu’Himmler en perdrait sa croix gammée :
L’Holocauste n’a pas existé, mais j’aimerais que ça soit le cas, des tas de corps sans valeur, putain de youpins pleurnichards, les juifs ne sont pas blancs, ils ne comptent pas, alors qu’est-ce que ça peut foutre si on s’en débarrasse ? Alors ramenez Hitler, ramenez le Fuhrer, et cette fois-ci, il faudra s’y prendre correctement !
Un couplet et la messe est dite. Evidemment, l’articulation de la pensée est inexistante, le propos toujours aussi haineux et sans fondement, témoignage d’un antisémitisme qui a agité les années 20 et 30 et qui trouve encore aujourd’hui un écho certain. Tout comme sous le régime nazi, le juif est réduit à un simple élément de son peuple, et son essence même n’a aucune validité une fois extrait de son contexte. Le hurleur en chef, Stooley Carmichael (parodie en foutage de gueule de Stokely Carmichael, activiste Black Power des années 60) se gargarise de ses textes sans compromis, qu’il considère comme une haine justifiée et indispensable. Sorti en 1995, ce single a été édité par le label de circonstance Le Youpin Edenté, et présente quatre titres tous aussi répugnants les uns que les autres.
Outre les juifs qui sont évidemment la cible principale, on y trouve aussi une charge virulente contre les américains blancs qui empruntent les codes des afro-américains, et qui sont donc traités de Whiggers (Contraction de white niggers si vous n’aviez pas compris), mais aussi un vomissement adressé aux hillbillies qui couchent entre frères et sœurs et qui se gargarisent de bière bon marché. Le lot habituel de la pseudo résistance néo-nazi américaine dans toute son horreur généraliste.
Musicalement, le tout est joué comme du mauvais Hardcore, sans aucun sens du rythme, et avec une guitare qui semble méchamment désaccordée. Le timing ne s’étire pas au-delà de la poignée de minutes, et ressemble parfois à une très mauvaise copie des CRYPTIC SLAUGHTER, même si utiliser ce nom dans le même contexte que celui d’ETHNIC CLEANSING me révulse.
ETHNIC CLEANSING, c’est la face immergée de l’iceberg musical raciste. Le genre de groupe que l’on ne connaît que si l’on fait partie de certains bords. A une époque, sa musique était disponible sur la toile sans avoir à passer par des sites référencés ouvertement racistes. C’est la curiosité morbide qui m’a poussé à écouter leur « musique », et à découvrir leurs textes ignobles qui nient toute humanité, mais aussi toute forme d’intelligence. Seulement, à une époque où la xénophobie et la lutte de territoire font rage, ce genre d’enregistrement se fait l’écho d’un racisme ordinaire qui commence à prendre ses aises au sein de certains gouvernements. Entre les deux dernières présidentielles françaises et la présence de Marine Le Pen au second tour, l’investiture de la fasciste Giorgia Meloni à la présidence du Conseil italien, le parti grec Aube Dorée, ou l’importance prise par le parti des Démocrates de Suède dirigé par Jimmie Akesson, le fascisme, racisme, haine de l’autre semble revenir sur le devant de la scène, comme si la haine était la seule défense contre l’inégalité et le sentiment d’insécurité.
Et c’est là que l’on dit adieu à l’art, lorsqu’il ne sert que de vecteur à une idéologie dangereuse. Il n’y a rien d’artistique dans la démarche d’ETHNIC CLEANSING et des milliers de groupes qui lui ont emboîté/précédé le pas. Juste une envie de cracher sa haine de l’étranger, du juif, du noir, et de tout ce qui n’appartient pas à la suprématie blanche telle que l’envisageaient les sudistes, les fascistes, les nazis et autres oracles d’infortune. Nous sommes-là bien au-delà d’un sentiment de simple dérangement, ou d’oppression. Nous avons franchi la limite du supportable.
32 - ZENJIN - Pseudoscorpion (Unknown)
Nous arrivons là au bout du chemin, là où l’ascenseur de l’indécence et de l’ignominie se bloque irrémédiablement. Toutefois, une précision s’impose. Alors que toutes les entrées de ce dossier finissant sont des œuvres réelles et facilement disponibles, ce dernier exemple hésite entre la vérité du Net et la légende urbaine du Dark Net, les deux camps étant incapables de se mettre d’accord. On osera affirmer qu’il a été vérité fut un temps peut-être, mais qu’il appartient désormais au monde du fantasme morbide.
Quel album peut donc mériter cette place et cette indignation, spécialement de la part de quelqu’un qui estime avoir vu et entendu les pires choses sur le Clearnet/Dark Web ? Tout simplement son concept ignoble, et son absence totale de dimension artistique.
Un beau jour, sur le canal /mu/ de Reddit apparaît un lien vers un album mystère, avec pour seule indication un nom et un titre : ZENJIN, Pseudoscorpion. Jusque-là rien d’anormal, les posts anonymes fleurissant sur le site en permanence, mais une fois que quelques curieux se sont emparés de l’affaire et cliqué sur le lien pour télécharger l’album en question, la consternation et l’interrogation ont laissé place à l’horreur et la condamnation.
A l’inverse de Mikko Aspa qui avec son projet NICOLE 12 s’épanche en fantasmes qu’on espère fictifs sur une bande sonore Power Electronics, ZENJIN (pseudo qui visiblement cacherait une figure de l’underground appréciée des spécialistes et des amateurs de borderline en tout genre) propose la démarche inverse : il ne s’agit plus de fantasmes, mais bien de faits, puisque cet « album » n’est rien d’autre qu’une compilation en mode field recording à la manière du Buyer’s Market de Peter SOTOS.
Mais encore une fois, si la démarche de SOTOS pouvait toujours paraître irrespectueuse, en plaçant dans un contexte pseudo artistique les témoignages de victimes de viols et d’abus physiques, il restait un semblant de dignité au projet qui se contentait de reproduire telle quelle la parole brisée de femmes et enfants détruits physiquement et moralement, sans donner tribune à leurs bourreaux.

Pseudoscorpion se décompose (toujours selon la légende) en six pistes de durées variées. Chacune est baptisée d’un seul mot, « Teacher », « Healthy », « Tara », « Assortment », « Consequences » et évidemment « Pseudoscorpion ». Et chacune de ces pistes n’est finalement que le flux audio extrait de vidéo p*dopornographiques. Rien de plus ni de moins.
Aucune ambition artistique, juste le plaisir de la transgression en proposant en tant que « musique » des témoignages audio infâmes extraits de vidéos ne l’étant sans doute pas moins. N’ayant évidemment pas vu ce genre de vidéos, je ne peux qu’imaginer avec peine ce qu’elles contiennent, même si quelques utilisateurs de Reddit ont eu la « gentillesse » de partager leur expérience. En découvrant l’album, nous aurions donc eu droit au viol d’une enfant par ses deux parents, une leçon de fellation par un père désireux d’apprendre à sa fille à se comporter comme une grande, mais aussi, à la bande-son de l’ignoble « Daisy’s Destruction », qui a alimenté les gazettes sombres du Net pendant des années. Cette vidéo réalisée par le pervers meurtrier (mais heureusement condamné) Peter Scully est l’une des affaires les plus sordides de la toile qui pourtant en a connu quelques-unes, et sert ici de conclusion à un « album » aussi condamnable que les supports qu’il utilise.
Mais alors, se pose la question : pourquoi ? Pourquoi en effet avoir balancé un truc pareil sur Reddit, en sachant très bien que le lien allait rapidement être supprimé par l’hébergeur ? Pourquoi prendre de tels risques puisqu’il faut bien que l’auteur du projet ait été en possession des vidéos originales pour en extraire les pistes audio ? Fantasme ultime de pervers ou provocation la plus gratuite et écœurante ? Quelle que soit la réponse, le problème reste le même. Tout ceci est atroce.
Je n’ai jamais écouté cet album, et je ne peux en aucun cas prouver son existence. J’ai regardé des vidéos traitant de son cas sur YouTube, de la part de personnes l’ayant prétendument écouté, lu des articles et des témoignages, et si certains affirment qu’il est toujours disponible quelque part sur le Clearnet, les liens Mega et Mediafire sont morts depuis longtemps. Il est donc impossible de savoir si toute cette affaire est réelle, ou bien un simple coup monté par des utilisateurs de Reddit pour alimenter les fantasmes les plus fous…et illégaux.
Ici, la question de l’art ne se pose plus, puisque aligner six pistes audio de vidéos p*dopornographiques n’a rien d‘une création. Qui plus est sans proposer un background justificatif, qui pourrait expliquer la démarche. Et que l’histoire soit inventée ou réelle ne soulève aucune question supplémentaire. Le simple fait d’avoir imaginé une histoire pareille n’a pas sa place dans l’univers adolescent des Creepypastas, ces petites vignettes horrifiques de fiction utilisant les légendes urbaines pour contaminer le quotidien de ses lecteurs.
Si la légende autour de cet album en est toujours une, l’existence des vidéos incriminées ne saurait quant à elle être remise en doute. On sait que le Dark Web regorge de sites illégaux proposant du contenu infantile, malgré les différents raids du FBI et des hackers. « Daisy’s Destruction » par exemple est une véritable vidéo, citée lors du procès de Peter Scully, et montrant le prévenu violer une petite fille en compagnie d’une femme. Sachant qu’après les faits, Scully a fait creuser à une enfant sa propre tombe, voilà qui ne laisse aucun doute planer quant à la véracité de ces horreurs sur le Web.
Vous aurez compris qu’avec Pseudoscorpion, nous avons atteint et même franchi la limite séparant le mauvais goût de l’impardonnable, de l’art et de la monstruosité humaine. Difficile d’aller plus loin qu’un tel projet, à moins d’utiliser des vidéos de snuff pour rendre la chose encore plus ignoble.
Sans avoir plus d’éléments, je ne peux donc garantir l’existence de cet album, mais je n’ai pourtant aucun doute sur sa véracité. Le net étant truffé d’horreurs en tous genres, Pseudoscorpion n’est qu’une image fugace dans une mer de cauchemars, et une toute petite étape franchie vers l’apocalypse des sens. Après tout, les vidéos compilées dans les trois volumes de MDPOPE sont là pour prouver que l’intérêt de l’homme pour sa face la plus sombre est toujours aussi grand, alors, pourquoi douter de l’existence d’un tel album sous prétexte qu’il a été posté sur le Clearnet ?
Bienvenue dans la lie de l’humanité qui n’en est plus que de nom.
(Ici s’achève ce dossier, et j’espère vous avoir fait découvrir des choses intéressantes. N’hésitez pas à laisser d’autres exemples pertinents dans les commentaires, ou faites comme d’habitude, insultez l’OP et le reste du staff du site. Après tout, c’est de circonstance, et nous avons l’habitude.)
Commentaires (12) | Ajouter un commentaire
Jus de cadavre
membre enregistré
Excellente idée de dossier ! Et l'intro est très juste !
De mon côté, la dernière chose vraiment dérangeante découverte reste l'album Caligula de Lingua Ignota, abordé dans le dossier.
Le genre de truc qui fout mal à l'aise (d'autant plus en connaissant le sujet de l'album et l'histoire perso de Kristin Hayter). Et pourtant, sans vanité, il m'en faut pour me secouer, vu toutes les horreurs qu'on s'envoie à longueur de temps .
Bref, encore plein de trucs à découvrir.
NecroKosmos
membre enregistré
Oh, cela semble bien intéressant. Du bon boulot visiblement. Je vais prendre mon temps et éplucher tout cela.
RBD
membre enregistré
Que voilà un parcours ardu, qui tombe bien pour la saison des chemins de croix…
Il y a des choses que je ne connais pas du tout, dans cette sélection. Par exemple, Deadsy. Est-ce ce fils-là de Cher qui avait fait jouer Cannibal Corpse en concert privé pour son anniversaire ?
"Strange Fruit", Penderecki, Diamanda Galas, Charles Manson ou Tori Amos étaient incontournables. Chez Siouxsie, j'aurais pensé à sa reprise d'"Il est né le Divin Enfant", mais c'est judicieux de l'avoir incorporée à ce parcours, car c'est une écorchée par-delà son image de Gothique Poppy.
Bravo pour avoir honoré Lingua Ignota, que j'ai découvert sur scène il y a quelques années et qui ne laisse pas indifférent. Pharmakon est au moins aussi angoissant mais je ne connais pas assez son répertoire pour choisir un titre en particulier.
Comme suggestions je songe tout d'abord au vieux tube de Depeche Mode "A Question of Time" est également très malsain (et proche d'un thème abordé en fin de ce parcours), quand on veut bien se pencher sur ses paroles, avec cette ligne puissante et simplissime de synthé -imparable, souvent reprise à la guitare maintenant et qui abolirait presque le discernement quant aux couplets.
"Le petit chevalier" de Nico est parfaitement dérangeante également. Elle est très courte, chantée par Ari Boulogne alors enfant (c'est le fils que l'ex-actrice ex-Velvet Underground a eu d'Alain Delon, qui n'a jamais voulu le reconnaître malgré les évidences), et fait partie d'un album minimal, austère et pourtant très ésotérique.
Je m'étonne un peu que Throbbing Gristle ("Discipline" ou "Almost a Kiss") ou Coil (la reprise de "Tainted Love" par exemple) soient cités indirectement seulement. Au rayon Industriel, il y aurait de quoi faire. Laibach paraît trop attendu avec sa kyrielle de reprises, mais "Get Back" ou "Vaticana" mettent vraiment mal à l'aise quand on veut bien mettre de côté les a priori sur un groupe qu'on croit trop connaître. Chez Boyd Rice j'aurais pensé tout de suite à "Total War", comme une évidence, mais le titre retenu ici est plus recherché. Dans la même direction et pour finir en France, il y a aussi Les joyaux de la princesse et son "In Memoriam Philippe Henriot". Mais là on s'approche de certaines propositions de cette liste que je n'irai même pas essayer, pour ma part.
Pomah
@109.221.179.129
Mon dieu que tu as fait un taf énorme ... bravo, tu as du en chier par moment.
Évidement je n'irai jamais voir ou écouter les bas fonds de cette chronique, mais cela m'a tenue en haleine au point de m'en écœurer...
On vit dans un monde de sacré cinglé...
Pour Aspa, je comprends même pas ce que certains lui trouve... une énorme fiente musicale les 90% de ses groupes...
Pomah
@109.221.179.129
+1 pour le petit clin d'œil a Feldup.
Humungus
membre enregistré
Super taf comme d'hab' mortne2001.
Je ne connaissais de tout cela que la fameuse reprise de Nina Simone.
Le reste a donc été pur découverte pour moi.
Bon... Faut pas se leurrer, je n'ai pas tout trouvé génial hein. Beaucoup de chansons sont à mon goût plus que dispensables et pas si glauques que ça d'ailleurs.
Par contre, dans le rayon grosse claquasse, UGK, DIAMANDA GALAS (qui a littéralement rendu hystérique le chat de ma chère et tendre), CLASSROOM PROJECTS et surtout LA PERVERSITA, cela se pose là bordel !
KRYSZTOF PENFDERECKI me disait quelque chose musicalement : Et en effet, il apparait sur la bande son du film monument SHINING qui est pour moi la quintessence de la musique de film ultra flippante.
Et pour finir, je sais désormais a qui appartient ce faciès plus que disgracieux ornant la pochette du effectivement fantastique "Feel the darkness" de POISON IDEA.
PS : Perso, dans le genre sordide, STALAGGH est un putain de must.
mortne2001
membre enregistré
Je vous remercie de vos retours, et je suis vraiment content que ce dossier vous plaise, le sujet étant parfois très loin du Metal. Je ne me prétends ni auteur et encore moins journaliste, je suis juste quelqu'un comme vous, un passionné qui partage quelques trucs, alors quand je constate que le partage est apprécié, et que vous citez vos propres exemples, je suis content.
Alors merci à vous encore une fois.
Humungus
membre enregistré
En conseillant cet article à un ami, il m'a renvoyé vers ça :
THROBBING GRISTLE - hamburger lady (live Turin 2005.06.29) - YouTube
Effectivement... C'est du lourd aussi.
Orphan
@193.248.54.231
@Humungus : Oh que oui STALAGGH et son triptyque projekt c'est du très très lourd ! - je crois que Feldup en a parlé - je garde précieusement mes CD
Dans un autre registre mais qui fait son effet, il y a aussi l'album
Battle Of Mice: A Day Of Nights : https://www.youtube.com/watch?v=ZtkDfOMNBOo
A écouter dans son entièreté
(mais pour spoil : At the Base of the Giant's Throat le fin tiré d'un appel téléphonique crée un malaise sidèrent après 30mn d'écoute)
L'album est une dinguerie - Julie Christmas ayant été poussé à bout par Josh Graham, et cela s'entend notamment sur le morceau de clôture Cave of Spleen - Mention spécial à titre personnel pour Salt Bridge probablement l'un de mes morceaux préféré tout genre confondu.
Il y a bien la question du RAP qui se pose si tu veut ouvrir la porte de l'antisémitisme, du racisme, de la culture du viol, du meurtre etc...Nick Conrad, Freeze Corleone et TELLEMENT d'autres.
Pour les plus courageux, on peu parler de "musique" salafiste djihadistes - il s'agit surtout de chant a cappella - si tu y met des images comme on peu le voir sur Telegram - monté par les salafiste eux-mêmes - alors question horreur les nazillons évoqué plus haut, c'est du pipi de chat.
Enfin - une vraie transgression dans notre milieu - je laisse la parole à celui qui en parlera mieux (je me fou du mec qui en parle - en revanche sa conclusion ainsi que sa vidéo est on ne peut plus juste)
https://www.youtube.com/watch?v=BndUOKCliBE
Orphan
@193.248.54.231
Taf remarquable au demeurant !
(Ravi qu'on entende parler de Diamanda Galas aussi)
mortne2001
membre enregistré
@Humungus : Oui "Hamburger Lady" est en effet un incontournable, mais présent dans trop de listes pour que je le mentionne ici.
@Orphan : Tout à fait d'accord pour Battle Of Mice, l'album est vraiment atypique et extraordinaire. Et merci pour le lien vers la vidéo. Très intéressant.
Anastasia
@92.91.109.156
Merci pour cet article bien documenté et exhaustif !
Ajouter un commentaire
Derniers articles
Concerts à 7 jours
Tags
Photos stream
Derniers commentaires
Il est impossible que j'aie grossi. J'oubliais de signaler que Robert Plant aussi est venu cette ann&(...)
04/08/2025, 14:50
1) "Donc il n'y a pas de son dégueulasse ou pas en fait. C'est à juger au cas par cas"Bien évidement que quelquefois cela dépend de l'endroit où on se situe en salle...Mais si les 3/4 des gens présents et ce à(...)
04/08/2025, 08:36
Une review est tjs très subjective et peu importe l'expertise qu'on essaie d'y mettre du haut de nos "je suis fan depuis x années" "j'ai fait x concerts". Je n'ai fait que le concert du dimanche et c'était mon 3e sur la tournee a(...)
04/08/2025, 06:33
Ceci dit je maintiens "La ligne entre reformation et tribute band devient de plus en plus floue et j'aime pas ça, j'y trouve un manque d'honnêteté."Même récemment les groupes qui jouent d'anciens titres sur la nostalgie et qui (...)
03/08/2025, 21:47
Ouais en fait t'as probablement raison sur toute la ligne, fait chier pour mon argument.
03/08/2025, 19:34
- "Des ados peinturlurés façon Abbath dans un t-shirt de Korn qui posaient très sérieusement. Les pichous du village attendaient à la sortie pour casser du Metalleux histoire de briser l'ennui, et la police fouillait ma R5 à la lampe-torche quan(...)
03/08/2025, 08:36
"habitué à 1h30 rappels compris"...????? J'en suis à 23 shows, et jamais ils ne font moins de 1h45 "rappels compris....Les critiques sur Dave, je ne comprends pas trop. Je l'ai trouvé excellent les 2 soirs (et également &agr(...)
02/08/2025, 14:14
Oublié leur premier album depuis février ? Les ravages de la drogue surement...
02/08/2025, 08:59
@DPD : pathétique? Honnête plutôt. Il est très certainement passé à autre chose et n'a surement pas l'envie de ressortir des vieilleries de 30 ans (eh oui, 30 ans) et je le comprends parfaitement. Bref, le contraire de Cavalera qui doit vivre dans(...)
02/08/2025, 07:23
Je ne suis pas égalitariste il est évident que certains méritent plus mais bon tout ces gens vivent dans une social-démocratie, c'est pas comme si ils peuvent pas tirer du fric de l'Etat en cas d'urgence.
02/08/2025, 00:59
@OlivC'est ce que je me tue à dire, les cachets indécents des gros font que les groupes plus UG touchent les miettes. La scène n'a pas à être comme ça. Vite dit basiquement vous payez principalement pour Dimmu Borgir que vous le voulez ou (...)
01/08/2025, 21:39
@UdufruJe trouve pathétique qu'il aye refusé de bouger son gros cul de son studio, étant la moitié du projet. Je connais mal le groupe mais bon....il aurait pu faire l'effort La ligne entre reformation et tribute band devient de plus en plus floue et j(...)
01/08/2025, 21:32
effectivement bien black speed thrash crade ! la bonne recette lol merci pour la decouverte
31/07/2025, 18:02
J'étais pour ma part présent le samedi...J'emmène ma gamine de 9 piges à un "gros" concert chaque année et ce depuis 3 ans, donc c'était forcément une obligation pour moi en 2025 que de lui faire enfin voir la b&ecir(...)
30/07/2025, 09:58
Je t'en prie @Simony et merci à toi pour ce live report car j'étais curieux de l'avis de quelqu&ap(...)
30/07/2025, 00:27
Ah pardon, je n'ai pas entendu ces mots là, effectivement ça change l'interprétation de ce qu'il a voulu dire.... sacré Bruce. Le "pour être exact" c'était plus pour moi, pas pour toi @Ivan Grozny
29/07/2025, 21:49